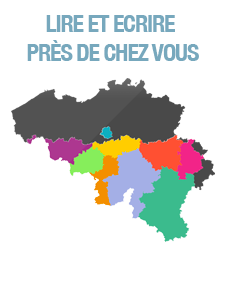Télécharger l’article (PDF).
Un des éléments du conflit prendrait sa source dans ce qui peut opposer les chercheurs des différents types de sciences, « naturelles » en ce qui concerne les neurosciences, « humaines et sociales » en ce qui concerne les sciences de la formation. Ces sciences faisant par ailleurs toutes appel aux sciences « formelles » telles que les mathématiques.
Cependant, quel que soit le type de discipline, des différences existent également entre les chercheurs qui s’intéressent à un aspect particulier – par exemple, l’entomologiste qui étudie la patte arrière droite de l’insecte machin – et ceux qui s’intéressent à la globalité – l’entomologiste qui étudie l’écosystème de l’insecte machin.
De plus, la distinction entre sciences dites « dures » (qui seraient « inhumaines » ?) et sciences humaines (qui seraient « molles » ?) ne tient pas lorsque l’on pense, par exemple, aux sciences de l’information et de la communication qui se sont construites en réunissant philosophes, psychologues, ethnologues, sociologues, biologistes, thérapeutes, politologues, linguistes, technologues, informaticiens, mathématiciens… et font appel à une grande diversité de savoirs [2]. Il en est de même pour les sciences de l’éducation et de la formation.
Méthodes de recherches
Ce qui fait la science, ce serait dès lors la méthode utilisée, qui se doit d’être « scientifique ». Les sciences « exactes » reposent sur un jeu d’hypothèses – ce qui fait intervenir imagination et choix (elles ne sont donc pas « neutres ») –, puis sur un processus expérimental de vérification et de validation. L’expérience scientifique se distingue d’autres expériences en ce qu’elle requiert l’application d’un protocole d’expérimentation permettant de reproduire précisément une expérience particulière.
Cependant, certaines théories des sciences naturelles, tout en étant scientifiques, échappent à ce processus. Les théories sur le Big Bang, par exemple, ne sont pas toutes vérifiées au sens expérimental du terme, pour des raisons évidentes ayant trait à la nature du sujet d’étude. Des calculs suppléent parfois au principe de vérification, alors qu’en sciences humaines, des hypothèses – telles que l’« effet pygmalion » – sont confirmées par des expérimentations qui ont toutes les caractéristiques scientifiques. Elles en remplissent la condition d’être transposables et réappropriables par d’autres chercheurs, permettant ainsi leur réfutation.
Aujourd’hui, une véritable guerre des sciences ayant pour objet la preuve scientifique et la légitimité scientifique de différents types de recherche se déroule dans le domaine de l’éducation [3].
Un des éléments du conflit prend sa source dans l’opposition entre des modalités différentes de construction et de validation de la connaissance. Un but des sciences naturelles est de comparer des évènements “toutes choses égales par ailleurs”, un objectif inatteignable en sciences humaines du fait de la multiplicité des paramètres impliqués dans une situation “hors laboratoire” ; réciproquement, les sciences humaines se donnent comme objectif d’appréhender et modéliser la complexité des interactions humaines, complexité inaccessible si on étudie des individus isolés dans un lieu aussi peu commun qu’un caisson d’IRM
[4] ou une table d’opération. Oppositions aussi entre rapports distanciés ou engagés du chercheur avec son objet de recherche, approches explicatives ou approches compréhensives, approches quantitatives ou approches qualitatives, travail en laboratoire ou sur le terrain… [5]
Deux modèles de recherches en éducation se développent actuellement dans un contexte politique de « gouvernance par la preuve », et s’ancrent ou veulent s’ancrer dans les « vraies sciences » bien dures : la « neuro-imagerie de l’activation du cerveau » et « l’expérimentation par assignation aléatoire » (randomized controlled experience). Ces modèles sont cependant tout aussi sujets à la critique scientifique que les modèles centrés sur l’observation et les analyses de pratiques réelles sur le terrain, ni plus ni moins que les recherches participatives, dont celles menées en croisement des savoirs et des pratiques.
Neuro-imagerie et activation du cerveau
Les recherches en neurosciences cognitives de l’éducation ont progressé principalement grâce aux techniques récentes d’imagerie et de stimulation cérébrale non invasives, principalement : l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), la tomographie par émission de positons (TEPscan), l’électro- et la magnétoencéphalographie (EEG et MEG), la stimulation magnétique transcrânienne (TMS) [6]. Ces techniques sont en évolution constante.
Comme toutes les autres méthodes de recherches, la neuro-imagerie fait l’objet de nombreux débats : méthodes très fastidieuses, choix des échantillons, tests forcément simples pouvant être ambigus et souvent peu interrogés, fiabilité des calculs, non-confirmation des résultats d’expériences précédentes…
De manière plus spécifique, les critiques adressées à cette méthode sont les suivantes.
Elle est basée sur l’hypothèse que ce sont les aires cérébrales activées lors de la réalisation d’une tâche qui sont impliquées dans le processus mental testé. Cette hypothèse est à ce jour non vérifiée. La connaissance des neurones réellement activés est encore très lacunaire et le rôle des aires cérébrales remis en cause.
Elle risque également de nous faire prendre une corrélation pour une cause. Voir des zones cérébrales corrélées, par exemple à des activités de lecture ou au calcul mental, ne veut pas dire qu’elles en sont totalement responsables.
Il faut également rester vigilant face aux images du cerveau et à leur vulgarisation. La neuro-imagerie nous donne l’illusion de voir l’activité du cerveau en temps réel. Cela concourt à notre fascination mais nous ne devons pas oublier que nous ne savons pas lire ces images. Les interpréter demande des compétences spécifiques. Les images du cerveau nous donnent, par exemple, l’impression que les zones non activées sont au repos. Et c’est d’ailleurs comme cela qu’on les appelle. Mais il n’en est rien.
Ensuite, les « images » du cerveau obtenues lors des expérimentations ne sont pas des « photos ». Elles sont fictives, même quand elles prennent l’apparence de cartes en couleurs ou de réseaux. Les traits et les couleurs que nous voyons sont le résultat de calculs mathématiques. Paradoxalement, maintenant que la plupart des images scientifiques sont fictives, elles acquièrent un statut d’objectivité, alors que longtemps les images, liées à l’imaginaire (le mensonger) et à l’imagination (la fuite de la réalité), ont eu une connotation négative pour les sciences. Les images scientifiques, tout comme les images d’art et celles de fiction, portent la marque de leur “relativité” et n’échappent en aucune façon à la critique historique. Ou, si l’on préfère, les images scientifiques n’accèdent pas à une dimension, à la fois universelle, neutre et objective comme on tente parfois de le faire croire.
[7]
Enfin, l’imagerie cérébrale entraine des questionnements philosophiques. Elle postule une « biologie de l’esprit ». Les neurosciences cognitives se proposent d’expliquer physiologiquement les concepts les plus psychologiques comme l’intention, la conscience, les émotions, etc. Elles posent également la question des liens entre le biologique, le psychologique, le social et le culturel. Peut-on comprendre un individu si on ne prend pas en compte ses interactions avec autrui, ainsi que sa place et son rôle dans la société ?
De l’IRM au terrain, une vision expérimentale du monde : la méthode RCE
Un mode de recherche qui est de provoquer des changements sur le réel pour mieux le comprendre se développe actuellement. Cette méthode d’« expérimentation par assignation aléatoire » (traduction de randomized controlled experiment – RCE) – ou « essais aléatoires » ou « tests hasardisés contrôlés » – est basée sur celle des « essais cliniques randomisés » utilisés en médecine et par l’industrie pharmaceutique pour tester les médicaments. Ce modèle scientifique fonctionne sur le mode stimulus/réaction. Il a été transposé à l’économie et aux sciences sociales pour contribuer aux « politiques de la preuve ». Il suppose qu’il y a une réponse scientifique objective universellement valable aux questions d’ordre public, social, économique, éducatif… sur laquelle les décisions politiques doivent s’appuyer.
Cette méthode d’expérimentation est utilisée dans deux domaines qui concernent l’alphabétisation : l’éducation et la lutte contre la pauvreté.
Cette méthode d’expérimentation est celle recommandée et utilisée comme méthode de recherche en éducation, notamment par Stanislas Dehaene [8] qui défend que des sciences cognitives à la salle de classe, il ne reste qu’un petit pas à franchir
et qui, pour le franchir, a recours au concept d’« éducation fondée sur la preuve » et à celui d’« expérimentation » dont il fait l’une des plus belles idées que les scientifiques peuvent apporter à l’éducation
. Cette « belle idée » est présentée comme une réponse aux errements du politique : Chaque réforme avant son introduction devrait faire l’objet de discussions et d’expérimentations aussi rigoureuses que s’il s’agissait d’un nouveau médicament
[9]. Les recherches dans la salle de classe doivent dès lors répondre aux mêmes règles que celles qui sont menées en laboratoire : Seule la comparaison rigoureuse de deux groupes d’enfants dont l’enseignement ne diffère que sur un seul point permet de certifier que ce facteur a un impact sur l’apprentissage.
Cette approche d’expérimentation par « assignation aléatoire » se base sur la détermination de la question que l’on se pose et des variables que l’on veut étudier. À titre d’exemple, une recherche a été menée en Afrique à partir de la question : est-ce plus profitable pour la scolarité de distribuer des vermifuges ou des manuels scolaires ? Cette recherche s’appuie sur une méthodologie rigoureuse d’échantillonnage et de tirage aléatoire des échantillons : un échantillon qui reçoit le traitement « manuels scolaires », un échantillon qui reçoit le traitement « vermifuges » et un échantillon de contrôle qui ne reçoit rien. Cette recherche a montré qu’au lieu de financer des livres pour chaque enfant, il est possible, pour le même cout, d’être vingt-mille fois plus efficace en offrant un traitement contre les vers à tous les enfants africains.
Cette méthode d’expérimentation a été développée par deux économistes, Esther Duflo et Abhijit V. Banerjee [10], avec pour ambition de comprendre les mécanismes de pauvreté de façon « scientifique », afin de calculer et d’améliorer l’efficacité des programmes de lutte contre la pauvreté, d’évaluer les politiques d’aide au développement et de les réorienter vers plus d’efficacité. Si l’on ne peut qu’adhérer à la nécessite de réfléchir au pourquoi et au comment de l’aide au développement et à la volonté des chercheurs de cesser de réduire les pauvres à des caricatures et [de] prendre le temps de comprendre réellement leur vie, dans toute sa richesse et sa complexité
, on ne peut que se questionner sur la pertinence et les conséquences de la méthode des tests hasardisés et contrôlés pour les politiques sociales. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Nous sommes au 21e siècle, et au 20e siècle, des tests contrôlés, hasardisés ont révolutionné la médecine en permettant de distinguer les traitements qui marchent de ceux qui ne marchent pas. Vous pouvez faire les mêmes tests hasardisés et contrôlés pour les politiques sociales. Vous pouvez faire passer aux innovations sociales les mêmes tests scientifiques et rigoureux que nous utilisons pour les médicaments. En faisant cela, vous pouvez éliminer les jeux de devinette des politiques, en sachant ce qui marche, ce qui ne marche pas et pourquoi.
[11] Les arguments avancés sont les mêmes que ceux utilisés par ceux qui militent pour la « gouvernance par la preuve » en éducation.
Quelques exemples ont été médiatisés. Dont celui de l’éradication de la pauvreté avec un kilo de lentilles [12]. L’objet de cette recherche était de montrer que la mise à disposition gratuite de vaccins ne suffit pas pour atteindre les objectifs de vaccination d’une population. Encore faut-il rendre le centre de vaccination accessible – effectivement l’organisation de rendez-vous mensuels multiplie le taux de vaccination par trois – et pourquoi ne pas y ajouter un « incentive » : un kilo de lentilles par vaccination ? Ce qui, comme le montrent les résultats, multiplie alors par six le nombre de vaccinations. Voilà donc la solution… Soulignons que le taux de vaccinations reste, même avec cet incitant, inférieur à 50 %, ce qui est toujours insuffisant pour empêcher les épidémies.
Même si elles sont le fait de chercheurs qui quittent leurs labos pour aller sur le terrain, si elles partent de critiques fondées des politiques de développement et de lutte contre la pauvreté, et d’une volonté positive de développer des actions efficaces, ce type de recherche suscite de nombreuses critiques tant éthiques que méthodologiques.
Au niveau éthique, priver un groupe test d’un avantage que l’on pense bénéfique pose question. D’autant que souvent les résultats confirment le bon sens et que si on peut réaliser ces expériences dans les pays en voie de développement, ce ne serait pas possible dans les pays où les citoyens ont leur mot à dire sur l’opportunité de ces études. Ainsi, des entreprises ont arrêté ce type de recherche quand les chercheurs se sont fait accueillir violemment par les groupes contrôles privés des avantages octroyés aux autres groupes, un comité d’éthique a refusé un projet d’étude nécessitant de priver un groupe d’enfants de l’apprentissage de la graphie…
Au niveau méthodologique, ce qui questionne, c’est la prétention de supériorité et de scientificité méthodologique de ces études, alors qu’elles ne sont pas généralisables, que leurs résultats ne sont ni reproductibles ni universellement valables, qu’ils dépendent de la taille des échantillons, que ces études sont longues et couteuses (avec un cout parfois plus élevé que la mesure elle-même), soit des critiques semblables à celles faites aux approches participatives. On peut également douter de la capacité à n’isoler qu’une seule variable au vu du nombre important de variables à contrôler, notamment dans les salles de classe, et de l’hypothèse selon laquelle la variable isolée serait la seule à avoir une incidence sur le résultat final.
Ces études sur le développement et la pauvreté contribuent au développement d’une logique marchande des politiques publiques, dont celles de l’éducation. Observons aussi qu’elles choisissent de ne pas retenir l’option « formation ».
Si avoir un accès facile à un dispensaire et recevoir un kilo de lentilles en échange d’une vaccination permet de lever une des difficultés relevées qui est de passer de l’intention à l’action, cela ne travaille en rien l’autre difficulté relevée en lien avec les mythes et les conceptions fausses qui entourent la vaccination. Comme faire évoluer les conceptions est difficile, la possibilité d’action éducative n’est pas envisagée. Pourtant, d’autres champs de recherche, notamment en formation d’adultes, montrent qu’il est certes difficile mais néanmoins possible de modifier les conceptions et proposent des démarches et outils pour ce faire [13].
Même quand une de ces recherches montre que c’est l’approche éducative qui est la plus efficace, cette solution n’est pas prise en compte. Ainsi les recherches sur « comment utiliser au mieux 100 dollars pour améliorer l’éducation ? » montrent que le plus efficace c’est expliquez aux gens les bénéfices de l’éducation. Ça ne coute pas cher. Donc pour chaque 100 dollars que vous dépensez comme ça, vous créez 40 années supplémentaires d’éducation.
Pourtant c’est la solution « vermifuges » – qui crée presque 30 années supplémentaires d’éducation – qui a été retenue : Lorsque les jeunes dirigeants du monde ont vu à Davos les chiffres que je viens de vous montrer, ils ont lancé “Vermifugez le monde”. Grâce à cette campagne et aux efforts de nombreux gouvernements et fondations, 20 millions d’enfants en âge scolaire ont été vermifugés en 2009. Cette preuve est forte. Elle peut pousser à l’action. […] En soignant les enfants des vers intestinaux, vous créez une année d’éducation supplémentaire pour 3 dollars. […] J’ai commencé par le gros problème et je ne pouvais pas le résoudre. Alors je l’ai divisé en questions plus petites et j’ai des réponses à ces petites questions. Ce sont de bonnes réponses, scientifiques et solides.
[14]
Enfin, lorsque cette approche expérimentale ne permet pas de démontrer la supériorité de l’approche préconisée, ou quand un groupe a un résultat différent ou refuse les termes de l’expérimentation, les participants risquent d’être considérés comme « a-normaux », hors normes, déviants.
De l’IRM au terrain, une vision écologique/systémique du monde : l’observation et l’analyse des pratiques enseignantes et apprenantes
À l’opposé de la méthode d’expérimentation par essais aléatoires, de nombreuses recherches basées sur l’observation, l’analyse et la comparaison de pratiques enseignantes en situations réelles sont menées, selon des modalités variées. Elles peuvent porter sur l’observation dans la durée d’une seule école, comme la recherche menée sur la longueur (plus de 5 ans) dans une école Freinet située dans un « réseau d’éducation prioritaire » de la banlieue lilloise [15]. Ou sur le repérage – sur base de données quantitatives – des écoles en discrimination positive qui arrivent à casser le déterminisme social, leurs élèves ayant des résultats supérieurs aux résultats attendus, repérage débouchant sur la recherche des caractéristiques de ces écoles – leur nombre restreint permettant de les observer toutes [16]. Ou encore sur l’observation des pratiques réelles d’un grand nombre d’enseignants recrutés par appel à participation, comme la récente étude sur l’influence des pratiques d’enseignement de la lecture et de l’écriture sur les premiers apprentissages [17]. Critiquant la méthode RCE utilisée par S. Dehaene, et partant du principe que ce sont les pratiques réelles des enseignants qui sont importantes – et non pas l’une ou l’autre « méthode » stéréotypée que de fait aucun enseignant n’applique –, Roland Goigoux a construit sa recherche sur les bases suivantes : À l’opposé des démarches expérimentales qui provoquent un changement des pratiques pour mieux en comprendre l’impact, nous ne voulions pas transformer les manières de faire des enseignants. Nous voulions identifier les caractéristiques didactiques de celles qui s’avèrent les plus efficaces et les plus équitables. C’est pourquoi nous avons proposé de constituer un vaste échantillon d’enseignants s’inspirant d’approches didactiques très diverses. […] Notre objectif n’est pas de montrer la supériorité de telle ou telle méthode, nous voulions seulement identifier, sans apriori, les caractéristiques des pratiques qui s’avèrent les plus efficaces et les plus équitables.
Ces différentes recherches montrent qu’il y a effectivement un effet des pratiques enseignantes. Heureusement, tout n’est pas joué d’avance ! Enseignants et formateurs sont bien utiles ! Mais pas toutes leurs pratiques !
Ces recherches montrent également que les pratiques d’enseignement efficaces sont les pratiques qui réduisent les écarts de performances entre les élèves forts et les élèves faibles, soit des pratiques également équitables. Elles mettent en évidence que les écoles primaires en milieu populaire qui « fabriquent de la réussite » en français et en mathématiques présentent généralement un même profil d’efficacité, constitué de quelques éléments toujours présents.
Ces recherches sont donc tout aussi intéressantes pour guider la prise de décision politique que les résultats des modes de recherche précédents. Mais leurs résultats impliquent des modifications systémiques plus difficiles à expliquer et mettre en place qu’une prescription d’outils, mode d’action privilégié par ceux qui préfèrent chercher inlassablement la solution miracle qui permettrait à tous d’apprendre sans rien devoir modifier à l’environnement et sans rien devoir changer à la société.
Les recherches qui ont l’ambition d’aborder la complexité de l’apprentissage et des pratiques enseignantes ne sont pas non plus à l’abri de critiques [18]. Certaines de ces recherches peuvent être de type « processus-produits », basées sur une causalité linéaire : les chercheurs identifient les activités des professeurs (les processus) pour les mettre en relation avec les connaissances construites des élèves (les produits). Les performances scolaires des élèves sont envisagées comme étant directement le résultat du processus d’enseignement élaboré par le professeur. Cette vision « processus-produits » est limitative et ne peut rendre compte de tout ce qui se passe réellement dans une classe, de l’ensemble du processus « enseignement-apprentissage ».
Un moyen de résoudre ce problème consiste à considérer que les produits ne sont pas uniquement liés aux pratiques enseignantes, mais plutôt à la façon dont l’élève traite l’information proposée par le professeur. Dans cette optique, c’est moins ce que fait le maitre que ce que fait l’élève qui est déterminant. C’est donc l’activité de ce dernier qui sera étudiée. L’enseignant est vu, non pas comme un gestionnaire des performances des élèves, mais bien comme un organisateur des conditions d’apprentissage. C’est dans ce cadre que se situent de nombreux travaux qui associent des recherches concernant les apprenants et l’analyse de pratiques de formation, et ce tant dans le domaine de l’éducation que de la formation des adultes, dont l’alphabétisation. Citons notamment les travaux d’Elisabeth Bautier, d’Yves Rochex, de Jacques Bernardin, de Bernard Charlot, de Christine Barré de Miniac, de Jean-Marie Besse, de Bernard Lahire, de Danielle Mouraux… qui portent sur la construction des inégalités scolaires en lien avec les rapports à l’école, au savoir, à la langue, à l’écrit… des élèves de milieu populaire. Certains de ces chercheurs s’intéressent également aux rapports au savoir et à l’écrit des personnes en situation d’analphabétisme/illettrisme, croisant la route des chercheurs en formation d’adultes qui se sont consacrés aux questions d’analphabétisme, tels que Serge Wagner, Jean-Paul Hautecœur, Mary Hamilton, et aux apprentissages des savoirs de base, comme Véronique Leclercq qui a consacré sa carrière à la recherche sur ces questions [19].
Les critiques des méthodes d’observation des pratiques enseignantes portent également sur les aspects suivants :
- Les élèves apprennent et se modifient aussi en dehors de l’activité du professeur, de manière plus ou moins informelle, dans leur milieu social et culturel, et au moyen de multiples médiateurs humains mais aussi au moyen de médias technologiques ou non (revues, télé, ordi…).
- Ces pratiques peuvent impliquer la conception d’épreuves d’évaluation afin de déterminer le niveau des connaissances construites par les élèves, ce qui implique des choix. Le choix des variables susceptibles d’expliquer les résultats d’apprentissage est sujet à discussion. Et les résultats seront différents selon les choix opérés : choix d’évaluer des compétences ou choix d’évaluer des savoirs, choix des compétences et des savoirs à évaluer…
- Passer d’une causalité linéaire « processus-produits » à une causalité circulaire, condition d’une approche systémique, implique de lire une situation de manière multicausale et d’analyser les interrelations entre les différents acteurs. Dans une perspective systémique, les composantes cognitives, sociales, culturelles, affectives… sont interrogées dans leurs relations réciproques. La définition d’un objet d’étude dans une approche systémique conduit cependant inévitablement à se résigner à ne pas tenir compte de certaines interrelations.
Les deux exemples ci-dessous illustrent la nécessité pour toute recherche scientifique de poser des hypothèses et de faire des choix.
Pour l’Étude de l’influence des pratiques d’enseignement de la lecture et de l’écriture sur les premiers apprentissages, citée ci-dessus, huit sous-ensembles de questions relatives aux pratiques d’enseignement ont constitué la problématique de recherche. Cinq portaient sur l’enseignement : le code alphabétique et les procédures d’identification des mots, la compréhension des textes écrits, l’écriture, l’étude de la langue, l’acculturation à l’écrit. Et trois portaient sur le caractère de l’enseignement dispensé : les modalités de différenciation et d’aide aux élèves en difficulté, le climat de classe, l’engagement des élèves dans les tâches scolaires.
Dans une autre recherche [20], centrée sur la compréhension de la manière dont les enseignants s’y prennent pour lever ou éviter les malentendus face à l’apprentissage, les sept axes choisis pour guider les observations et la recherche des pratiques d’enseignement favorables ont été les suivants : l’attitude de l’enseignant vis-à-vis des erreurs des élèves ; la manière dont l’enseignant institutionnalise le savoir ; le degré et la forme de l’explicitation par l’enseignant des consignes et des attentes ; le choix et la régulation des tâches dévolues aux élèves (choix de tâches complexes ou segmentaires) ; la place que l’enseignant accorde aux « projets » et aux activités à dimension extrascolaire, ainsi que les précautions qu’il prend ou non afin que ces activités restent des occasions d’apprentissages scolaires ; la manière dont il gère le rapport entre les activités scolaires et les habitudes, façons de faire, manières de penser et croyances que les élèves possèdent de par leur appartenance sociale et familiale ; le degré d’exigences intellectuelles qu’il maintient à l’égard des élèves, quel que soit leur niveau scolaire préalable.
Un autre problème posé par les recherches centrées sur l’observation et l’analyse des pratiques enseignantes est celui de la définition de l’efficacité de ces pratiques. Est « efficace » ce qui produit l’effet attendu. Mais quels sont les effets attendus, les fins et les objectifs des pratiques enseignantes ? Quelles sont les missions de l’école, quels sont les buts poursuivis : instruire, éduquer, socialiser, personnaliser, orienter, professionnaliser… ?
De l’IRM au terrain, une vision politique du monde : les recherches participatives en croisement des savoirs et des pratiques
À l’opposé des recherches expérimentales en éducation et de la centration sur les aspects cognitifs individuels, de manière complémentaire aux recherches sur les pratiques enseignantes et apprenantes ainsi que celles sur les rapports au savoir, des recherches se centrent sur l’engagement en formation, sur l’autoformation, sur les histoires de vie, sur les pratiques culturelles, sur les aspects sociaux et culturels de l’utilisation des langages, sur l’impact des apprentissages… Une grande partie des recherches menées dans le champ de l’alphabétisation des adultes l’ont été dans ce cadre [21]. Cadre où les questions d’éthique – à qui profitent les recherches scientifiques ? – et le dessein de faire progresser la justice sociale se reflètent par la prédilection pour la recherche participative et la recherche-action ancrée dans le terrain.
Néanmoins, si les recherches participatives se développent, rares sont celles qui organisent concrètement la participation des non-scientifiques tout au long du processus de recherche. Il en existe cependant qui croisent savoirs d’action professionnels d’enseignants ou de formateurs et savoirs académiques de chercheurs, et produisent des propositions de leviers pour que tous puissent réussir [22].
Mais plus rares encore sont les recherches qui incluent les personnes les plus éloignées de la parole publique, telles que les personnes en situation d’illettrisme, d’analphabétisme, de pauvreté… Leurs témoignages sont fréquemment utilisés dans des recherches « sur », et à ce titre constituent des données de recherche aussi pertinentes que celles récoltées par les autres modes de recherche, mais peu nombreuses sont celles où les personnes concernées participent tant à la construction des questions de recherche qu’au choix des indicateurs et à la production de la connaissance, dans une perspective de recherche « avec ».
Ce mode de recherche participative en croisement des savoirs part du principe que pour construire une société sans illettrisme – ou sans pauvreté – les savoirs de tous, y compris des personnes vivant ces situations, sont indispensables. Il postule également que par la contribution et la mise en dialogue des différents types de savoirs, on obtient une meilleure compréhension de la réalité.
Dans les recherches en croisement des savoirs et des pratiques, il s’agit de mobiliser et de reconnaitre trois sources de savoirs, pluriels et complémentaires : le savoir théorique, académique ; le savoir d’action, professionnel ; le savoir d’expérience, qui se construit à partir de l’analyse du vécu. Mais le témoignage ne suffit pas. Il doit être analysé, confronté, s’articuler avec d’autres données pour bâtir un savoir d’expérience à croiser avec les autres types de savoirs. Ainsi, selon les coorganisateurs du colloque Construire les savoirs avec toutes ? [23], le premier enjeu scientifique consiste à concevoir la recherche autrement, partant du principe que les formes de savoirs et d’expériences sont plurielles. Il s’agit de croiser les savoirs tout au long du processus de recherche, de l’élaboration de la question de la recherche à l’analyse et à la diffusion des résultats, en passant par le choix des objets d’étude, des hypothèses et des méthodes d’enquête.
Ces recherches sont basées sur deux principes centraux :
- Savoir et compréhension nécessitent les points de vue de tous les concernés. Le croisement des savoirs apporte des connaissances inaccessibles aux seuls chercheurs.
- Donner voix aux personnes qui n’ont pas de voix, qui doivent bénéficier d’un soutien pour pouvoir se faire entendre.
Elles ont comme caractéristiques :
- de travailler à hauteur d’Homme, dépassant les visions paternalistes, éducatives, de contrôle social… et celles du chercheur qui parle d’« objet d’étude », même quand cet objet est un sujet qui a des connaissances et des savoirs ;
- d’être pacifiques : il s’agit de travailler/construire avec… et non de lutter contre…, ce qui constitue un important basculement de point de vue ;
- d’assumer une ambition théorique de production de connaissance dans des études nécessairement interdisciplinaires.
Elles suscitent questions et interrogations sur la construction de la connaissance, sur le langage, sur la nature des savoirs issus de l’expérience, sur les conditions du processus relationnel, sur les finalités et la validation de la recherche… Parce que les savoirs des personnes en situation de pauvreté sont habituellement peu visibles, parce que leur reconnaissance questionne les liens entre production des savoirs et rapports sociaux inégalitaires, ces recherches posent des questions éthiques, scientifiques et pratiques aux chercheurs comme aux professionnels, militants et personnes en situation de pauvreté.
[24]
Ces questions sont les suivantes :
- En quoi la coproduction de la recherche entre chercheurses, professionnelles, militantes et profanes apporte des connaissances nouvelles ? Quelles exigences fait-elle peser sur l’exercice de la recherche ?
- La manière de mettre en mots est une manière de penser originale, pas nécessairement compréhensible par quelqu’un d’extérieur. Comment être compréhensible sans quitter une parole pleine pour une parole désincarnée ?
- Chaque acteur se voit attribuer un type de savoir (académique, d’action, d’expérience). Dans la réalité, même si chacun est expert en son domaine, chacun possède, à des degrés divers, les trois types de savoirs. - - - Comment éviter les effets de catégorisation ?
- Est-ce possible de croiser les modalités de validation ?
- Comment développer la solidarité collective dans un contexte de dépendance à l’égard de l’aide sociale ?
- Quelle éthique pour préserver l’intimité, l’anonymat et pour assumer l’après-recherche… ?
- Quels biais liés à la participation à un collectif de militants, le plus souvent relié à une association ?
- …
On peut raisonnablement penser que la participation à une association ne biaise pas plus les résultats que la participation au forum de Davos… et que la coconstruction des questions de recherches par croisement des savoirs n’est pas moins pertinente que celles proposées par les chercheurs académiques. Outre les éléments cités ci-dessus, le colloque Construire les savoirs avec tou-te-s ? a mis en évidence les enjeux de ces pratiques qui renouvèlent les manières de voir et les manières d’agir en matière de recherche, et constituent un réarmement collectif de l’esprit critique, selon les termes de Catherine Neveu, chercheuse au CNRS :
- rendre visibles des personnes, des espaces, des enjeux du quotidien qui étaient invisibles ;
- rendre visibles des questions invisibles et des manières de poser ces questions, de les envisager, de les penser… ;
- mettre en lumière la capacité de tous à penser, à l’analyse et à la réflexivité ;
- rencontrer l’enjeu de l’égalité, pas uniquement l’égalité en dignité et en droit, mais également l’égalité concrète entre cochercheurs ;
- rencontrer l’enjeu de la reconnaissance des savoirs des personnes « sans voix » ;
- obliger à retravailler les mots, les catégories qu’on utilise ;
- obliger à expliciter le caractère situé des savoirs, y compris ceux du chercheur ;
- questionner les rapports sociaux inégalitaires dans la production et la validation des savoirs ;
- permettre aux acteurs non académiques de reconquérir un sentiment de légitimité et d’être reconnus comme sujets politiques participant à la transformation de la société ;
- …
Ces recherches sont non seulement susceptibles de contribuer à la décision politique mais elles sont les seules à pouvoir aller à l’encontre des propositions d’actions émises par et pour une classe sociale culturellement dominante. De très nombreuses recommandations sont par exemple adressées aux parents pour soutenir la scolarité de leurs enfants. Dans la pratique, leur mise en œuvre s’avère presque toujours impossible pour les personnes en situation d’exclusion.
Conclusion
Quel que soit l’angle d’approche, la recherche consiste à poser des questions, à dégager des tendances générales et à chercher, de façon systématique, l’information dont on a besoin pour répondre à ces questions
[25]. Relier le parcellaire et le systémique est indispensable à la connaissance, qui ne peut se construire que de manière interdisciplinaire et avec l’ensemble des acteurs concernés par la question posée. Aucune recherche, aucun chercheur, aucune proposition n’est « neutre ». Les recherches procèdent toujours de partis pris idéologiques. Il importe donc de rester critique et de situer les recherches et les propositions d’actions dans leurs différents enjeux institutionnels, personnels, scientifiques et politiques.
Catherine
Lire et Écrire Communauté française.