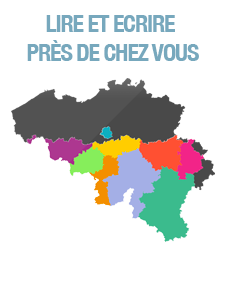De l’analphabétisme
Analphabète, illettré, quelle différence ?
Il n’existe pas de définition scientifique et universelle de l’analphabétisme et de l’illettrisme, donc des analphabètes et des illettrés. Ce sont des notions subjectives qui dépendent de décisions arbitraires.
Dans sa première définition de 1958, l’Unesco décrit l’analphabète fonctionnel comme une personne incapable de lire et d’écrire, en le comprenant, un énoncé bref et simple de faits en rapport avec la vie quotidienne
. Le plus souvent, cette personne a été à l’école sans pour autant y avoir acquis ces savoirs de base. Le terme « illettré », utilisé en France, peut être considéré comme synonyme d’analphabète fonctionnel.
Si la plupart des dictionnaires distinguent l’analphabète qui n’a jamais appris à lire et à écrire
de l’illettré qui ne maitrise ni la lecture ni l’écriture
, cette distinction est absolument inefficiente pour caractériser deux types de publics tant les histoires personnelles, les connaissances, les expériences, les représentations, les stratégies divergent d’un individu à l’autre. Elle ne précise pas non plus ce que l’on entend par « maitrise » de l’écrit.
En 1978, l’Unesco élargit sa définition : Une personne est analphabète du point de vue fonctionnel si elle ne peut se livrer à toutes les activités qui requièrent l’alphabétisme aux fins d’un fonctionnement efficace de son groupe ou de sa communauté et aussi pour lui permettre de continuer d’utiliser la lecture, l’écriture et le calcul pour son propre développement et celui de la communauté.
Il existe depuis 2023 une nouvelle nomenclature adoptée par l’ensemble des opérateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui définit clairement le périmètre de l’alphabétisation. Les cours d’alphabétisation s’adressent aux personnes qui ne maitrisent pas les langages fondamentaux (oral, lecture, écriture, calcul) et savoirs de base équivalents au CEB dans aucune langue. On distingue l’alpha pour francophone (où le public bénéficiaire est francophone) de l’alpha pour non-francophone (où le public bénéficiaire est non francophone).
Combien y a-t-il d’analphabètes en Belgique ?
Puisque l’analphabétisme est une notion subjective, il n’y a pas moyen de répondre à cette question.
L’enquête PIAAC 2012 de l’OCDE annonce, en Flandre, un taux de 14 % de personnes âgées entre 16 et 65 ans ayant des difficultés à comprendre un texte suivi (les résultats de l’enquête effectuée en 2023 sont attendus en décembre 2024).
L’enquête sur les forces de travail, indique qu’en Belgique, en 2023, 10 % de la population âgée de 15 ans ou plus n’ont pas de diplôme ou au maximum un diplôme de l’enseignement primaire (soit environ 965 266 personnes).
La Fédération Wallonie-Bruxelles n’ayant pas participé à l’enquête PIAAC, Lire et Écrire maintient le pourcentage habituellement avancé pour la Belgique francophone de 10 % de la population adulte analphabète ou illettrée. Une estimation réaliste si on la compare aux résultats obtenus par les enquêtes menées dans des pays comparables aux nôtres.
En France, l’enquête Information et Vie quotidienne menée en 2022, montre que 8 % des personnes âgées de 18 à 65 ans sont en très grande difficulté avec l’écrit. 4 % d’entre elles sont illettrées, c’est-à-dire qu’elles ont suivi leur scolarité en France depuis le début.
Quelle est la situation dans le reste de l’Europe ? Et dans le monde ?
Malgré l’augmentation régulière des taux d’alphabétisme depuis un demi-siècle, il reste encore, selon l’Unesco, 754 millions d’adultes analphabètes à travers le monde, pour la plupart des femmes.
Dans les pays industrialisés, la situation est semblable à celle de la Belgique.
Comment se fait-il que des gens sortent de l’école sans savoir ni lire ni écrire alors que l’enseignement est obligatoire ?
On constate effectivement que, en 2024, près de 13 % des enfants quittent l’enseignement primaire sans le Certificat d’études de base (CEB).
Les causes de ces échecs sont multiples. Elles sont le plus souvent liées à des ruptures familiale (placement, deuil, séparation…), scolaire (redoublement, changement d’école…) sociale (sentiment de rejet, inadéquation avec les codes de l’école), identitaire (perte de l’estime de soi et réaction de repli), culturelle (différence de langue et de rapport aux savoirs).
Elles sont également toujours liées à la relation difficile, voire antagoniste, entre une appartenance sociale et le « monde des savoirs scolaires », cela, dans le contexte d’un système scolaire particulièrement discriminant et inéquitable.
Plus globalement, Lire et Écrire considère que l’analphabétisme n’est pas un problème individuel mais a pour cause et conséquence l’exclusion sociale, culturelle, politique et économique sévissant dans notre société.
En Fédération Wallonie-Bruxelles, l’enquête PIRLS de 2021 montre que les élèves de 4e primaire sont les plus faibles lecteurs du groupe des pays de référence (soit 19 pays européens). 11 % des élèves de l’échantillon n’atteignent pas le niveau de compréhension de l’écrit le plus élémentaire de l’échelle (niveau 1), soit 3 % de plus qu’en 2016. Ils sont 27 % à atteindre le niveau de compétences de niveau 1. Il y a donc en FWB très peu de bons lecteurs et une proportion importante de lecteurs ne possédant que des compétences de lecture relativement rudimentaires.
L’illettrisme est-il à mettre en liaison avec des capacités intellectuelles limitées ?
Non. L’illettrisme est dû à un arrêt trop précoce de l’apprentissage ou aux difficultés décrites dans la réponse à la question précédente. Ces difficultés peuvent être résolues dans un contexte différent.
Quand estime-t-on qu’on n’est plus analphabète ?
Comme nous l’avons relevé plus haut, la notion d’analphabétisme est éminemment subjective et relative. Chacun définit les savoirs de base qu’il estime nécessaires pour mener à bien ses projets, en fonction de son environnement. Certains arrêtent les cours satisfaits de savoir écrire des messages simples, d’autres veulent savoir lire les courriers administratifs ou les communications envoyées par l’école de leur enfant…
Cependant l’évolution de la société conduit à mettre la barre de plus en plus haut et à élargir le champ des compétences. Ainsi, pour l’Unesco, en 1978, n’est plus analphabète toute personne qui a acquis les connaissances et compétences indispensables à l’exercice de toutes les activités où l’alphabétisation est nécessaire pour jouer efficacement un rôle dans son groupe et sa communauté, et dont les résultats atteints en lecture, écriture et arithmétique sont tels qu’ils lui permettent de continuer à mettre ces aptitudes au service de son développement propre et du développement de la communauté, et de participer activement à la vie du pays.
Pour sa part, Lire et Écrire estime que le champ de l’alphabétisation recouvre les savoirs de base acquis à l’issue de l’enseignement primaire.
De Lire et Écrire
Depuis quand existe l’alphabétisation des adultes ?
Si l’alphabétisation a existé de tout temps, c’est à la fin des années 1960 que des initiatives d’alphabétisation pour migrants, portées par des militants bénévoles, se sont multipliées et développées dans les principales villes du pays. Ces associations, qui existent encore aujourd’hui, sont à la base du développement et de la structure très majoritairement associative de l’alphabétisation en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Au début des années 1980, deux d’entre elles, ATD Quart Monde et le Collectif d’alphabétisation, ont constaté la persistance de l’analphabétisme parmi la population belge et ont attiré l’attention de l’opinion publique, des pouvoirs publics et des mouvements ouvriers sur cette problématique.
Par qui est organisée l’alphabétisation ?
Aujourd’hui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, des cours d’alphabétisation sont organisés par des écoles de Promotion sociale, des services publics, tels des CPAS, et environ 230 associations d’alphabétisation, dont Lire et Écrire.
En 2012, selon la dernière enquête menée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, plus de 20 000 personnes ont suivi des cours d’alphabétisation, de formation de base, ou de français langue étrangère (FLE) de base.
Rares sont les associations qui se consacrent exclusivement à l’alphabétisation. La plupart ont créé des cours d’alphabétisation pour répondre aux demandes des personnes qui participaient à leurs activités ou s’adressaient à elles pour l’un ou l’autre service.
Ces associations sont très diverses : maisons de quartiers, associations féminines, maisons de jeunes, maisons médicales, écoles de devoirs, centres culturels, bibliothèques, organismes d’insertion socioprofessionnelle ou d’accueil des primo-arrivants, centres d’expression et de créativité, associations d’Éducation permanente, etc.
Certaines reposent entièrement sur le volontariat ; d’autres ne travaillent qu’avec des salariés.
Depuis quand existe Lire et Écrire ?
Lire et Écrire a été créée en 1983, par quatre associations de formation continue et d’Éducation permanente, portées par les mouvements ouvriers chrétien et socialiste.
Lire et Écrire est structurée en régionales réparties sur l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces régionales sont coordonnées aux niveaux de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Pourquoi a-t-on créé Lire et Écrire ?
Lire et Écrire a été créée pour que tout adulte qui le souhaite puisse trouver près de chez lui une formation en alphabétisation de qualité adaptée à sa demande.
Elle s’est donnée trois grands objectifs :
- attirer l’attention de l’opinion publique et des pouvoirs publics sur la persistance de l’analphabétisme et sur l’urgence d’en combattre les causes et d’y apporter des solutions ;
- promouvoir le droit effectif à une alphabétisation de qualité pour tout adulte qui le souhaite ;
- développer l’alphabétisation dans une perspective d’émancipation, de participation et de changement social vers plus d’égalité.
Quelles sont les revendications de Lire et Écrire ?
Pour Lire et Écrire, il s’agit de revendiquer le droit à l’alphabétisation pour tous, c’est-à-dire :
- que chacun ait le droit de choisir librement une formation répondant à ses attentes et à ses besoins ;
- que chacun ait le droit de poursuivre cette formation le temps qu‘il juge nécessaire pour atteindre ses objectifs ;
- que chacun puisse trouver près de chez lui une alphabétisation de qualité, reconnaissant ses expériences et ses savoirs, ses capacités et ses rythmes d’apprentissage, sa culture et sa communauté ;
- que chacun puisse apprendre à lire et à écrire, mais aussi qu’il ait le droit de questionner et de réfléchir, de recourir à l’imagination et à la création, d’écrire et lire son histoire ;
- que chacun puisse accéder à une réelle participation économique, sociale, culturelle et politique, car sans cette participation, il n’y a pas de raison d’apprendre…
Outre cette revendication de base, Lire et Écrire produit régulièrement des cahiers de revendications précises à l’attention des différents pouvoirs publics.
La dématérialisation des services publics et d’intérêt général qui discrimine les personnes en situation d’analphabétisme (difficulté d’accès et perte de droits) constitue un nouvel enjeu pour Lire et Écrire.
Quelles sont les actions de Lire et Écrire ?
Lire et Écrire mène plusieurs types d’actions.
Elle organise des cours d’alphabétisation et propose différents services tels l’accueil et l’orientation du public, la formation de formateurs, le conseil pédagogique, des centres de documentation, l’édition et la diffusion de matériel pédagogique.
Lire et Écrire met en œuvre des campagnes de sensibilisation et d’interpellation politique, mobilise des réseaux d’acteurs, réalise des études et des recherches. Dans ce cadre, elle donne des séances de formation à destination des professionnels de terrain pour leur permettre de mieux accompagner et prendre en compte le public illettré.
Avec quels moyens fonctionne Lire et Écrire ?
Lire et Écrire reçoit des subsides des pouvoirs publics belges et européen. Lire et Écrire est une ASBL, reconnue comme mouvement d’Éducation permanente, les régionales wallonnes sont également reconnues comme organismes d’insertion socioprofessionnelle.
Depuis 2010, Lire et Écrire Bruxelles est mandatée comme Centre régional pour le développement de l’alphabétisation et de l’apprentissage du français pour adultes (CRéDAF).
Des publics
Y a-t-il un profil-type des personnes analphabètes ou illettrées ?
Non. Il n’y a pas de profil-type de ces personnes. Ces publics sont extrêmement diversifiés. Et ce, tant au niveau de leurs histoires de vie, de leurs parcours scolaires, de leurs situations familiales et socioprofessionnelles, de leurs cultures, de leurs acquis et de leurs projets.
Les analphabètes sont-ils tous des immigrés ?
Non. Il existe aussi des personnes d’origine belge en situation d’illettrisme. Comme nous l’avons évoqué à plus haut, l’école reste le produit d’une société inégalitaire et l’échec scolaire est trop souvent corrélé à l’origine sociale des élèves.
Quels pourcentages d’étrangers et de Belges y a-t-il dans les cours d’alphabétisation au sein de Lire et Écrire ?
Les personnes de nationalité étrangère sont majoritaires selon l’enquête menée en 2023 par Lire et Écrire dans ses propres lieux de formation : 73 % au total, mais 68 % en Wallonie et 76 % à Bruxelles.
Ces personnes proviennent pour la plupart de pays non européens. Notons toutefois qu’à Bruxelles, la grande majorité des apprenants de nationalité belge sont des personnes qui ont acquis la nationalité.
Les personnes qui suivent des cours d’alphabétisation sortent-elles toutes de l’enseignement spécialisé ?
Non. En 2023, 12 % des apprenants wallons à Lire et Écrire sortaient de l’enseignement spécialisé. À Bruxelles, pour la même année, moins de 1 % (0,7 %) des apprenants ont suivi l’enseignement spécialisé. Ces résultats très disparates entre les deux Régions peuvent s’expliquer par le fait que la majorité des personnes qui suivent des formations à Bruxelles ont souvent peu fréquenté l’école en Belgique.
Rappelons que près de 13 % des jeunes sortent de l’enseignement primaire normal sans avoir obtenu le Certificat d’études de base. Et nombre d’entre eux ne rattraperont pas leurs lacunes au cours de leur scolarité secondaire.
Il faut également souligner que la fréquentation de l’enseignement spécialisé de type 8 est très souvent davantage liée à des problèmes sociaux qu’à des problèmes cognitifs.
Y a-t-il plus d’hommes ou de femmes dans les cours d’alphabétisation ?
Il y a une majorité de femmes dans les formations à Lire et Écrire (65 % en 2023 contre 57 % en 2016, une tendance en légère hausse ces dernières années).
Quelle tranche d’âge est la plus représentée dans les cours d’alphabétisation ?
En 2023, la plus grande partie du public à Lire et Écrire (30 %) a entre 35 et 44 ans et 24 % ont entre 45 et 54 ans. La part des jeunes de moins de 25 ans est de 8 %.
Quelle est la situation socioprofessionnelle des personnes qui suivent une formation d’alphabétisation ?
En 2023, selon l’enquête statistique menée au sein de Lire et Écrire, 33 % dépendent du CPAS, 16 % sont demandeurs d’emploi indemnisés et 5 % ont un emploi.
3 % sont (pré)pensionnés et 5 % perçoivent une allocation autre.
28 % sont sans revenus personnels : femmes et hommes au foyer, demandeurs d’emploi non indemnisés, étudiants, demandeurs d’asile.
En 2012 [1], selon l’étude menée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, plus de 20 000 personnes ont suivi des formations alors qu’on estime à 400 000 le nombre de personnes en difficulté de lecture et d’écriture…
Comment expliquer cet écart ?
En dehors du fait que l’offre est effectivement insuffisante pour répondre à la demande, ces personnes peuvent :
- ignorer que des cours existent ;
- vivre mal leur situation d’analphabétisme, ne pas parvenir à vaincre peurs et tabous et ne pas oser pousser la porte d’une association ;
- ne pas vouloir apprendre à lire et à écrire ;
- ne pas éprouver le besoin de s’inscrire dans une formation ;
- ne pas se considérer comme analphabète, ne pas s’identifier à ceux que la société appelle « analphabètes ».
D’autre part, des problèmes de mobilité (absence de moyens de transports en milieu rural) et des problèmes d’horaires (peu adaptés aux travailleurs, par exemple) constituent également des freins à la participation.
Qu’est-ce qui motive les analphabètes à s’inscrire aux cours ?
On constate que les personnes viennent le plus souvent s’inscrire quand elles vivent une situation de changement : enfants qui rentrent à l’école, départ des enfants, perte d’emploi, veuvage… Situations qui entrainent de nouveaux besoins ou de nouvelles disponibilités et possibilités.
Apprendre à lire et à écrire n’est jamais une fin en soi mais un moyen pour :
- se débrouiller dans la vie courante ;
- devenir plus autonome dans ses démarches administratives, sa vie familiale, ses déplacements, ses loisirs… ;
- se servir des technologies de l’information et de la communication (TIC) ;
- trouver du travail ;
- suivre d’autres formations ;
- obtenir un diplôme ;
- acquérir plus de confiance en soi ;
- reconstruire une image positive de soi ;
- suivre la scolarité de ses enfants ;
- s’informer, développer ses connaissances, s’épanouir personnellement ;
- participer à la vie sociale, politique et culturelle ;
- accéder au monde de l’écrit et au plaisir de lire et d’écrire ;
- écrire l’histoire de sa vie ;
- etc.
Comment repérer les personnes en difficulté de lecture et d’écriture ?
Les personnes analphabètes n’osent pas toujours parler de leur situation et il n’y a pas toujours de signes et de comportements visibles à partir desquels on peut reconnaitre un analphabète.
On peut cependant être attentif à une série d’indices :
- un parcours scolaire chaotique et une absence de diplôme ;
- des difficultés à s’exprimer et à produire un récit cohérent (chronologie et emploi des temps, articulateurs logiques, syntaxe et vocabulaire approximatifs…) ;
- réticence, voire refus, sous différents prétextes, de remplir ou de lire des documents (
J’ai oublié mes lunettes.
,Je les remplirai à la maison.
,Pouvez-vous me dire quelles sont les offres d’emploi ?
,Je suis dyslexique.
, etc.) ; - refus d’une formation professionnelle, d’un poste de travail, d’une augmentation de ses responsabilités… ;
- écriture laborieuse de son nom et de son adresse ;
- etc.
Ce n’est pas un indice mais…
… les personnes analphabètes rencontrent aujourd’hui des difficultés importantes pour utiliser les outils numériques et effectuer des démarches administratives en ligne. Comme les usages numériques sont largement liés à une maitrise de l’écrit, elles sont, plus encore, impactées par ces transformations et les inégalités sociales qu’elles induisent.
Que faire face à une personne analphabète ?
L’expérience a montré qu’il est préférable d’en parler et qu’une discussion sur le sujet a des effets positifs car cela permet de dédramatiser la situation.
Pour faciliter la discussion :
- essayer d’en parler le plus normalement possible ;
- dire qu’il y a beaucoup de personnes qui rencontrent le même problème ;
- faire apparaitre que ce n’est pas une question de « tare » personnelle, que la personne n’est pas responsable de cette situation ;
- souligner et valoriser les autres savoirs et compétences de la personne ;
- dire qu’il est possible de faire quelque chose, notamment de suivre des cours pour adultes ;
- dire que suivre une formation alpha ce ne sera pas comme à l’école ;
- proposer d’aider à établir le premier contact avec Lire et Écrire ou une autre association d’alphabétisation ;
- …
Il est également important d’analyser les demandes et besoins réels de la personne et de ne pas lui proposer, comme seule et unique solution, une formation d’alphabétisation.
La priorité de la personne peut être de régler des problèmes de survie, des problèmes personnels ou sociaux, de trouver du travail, de participer à d’autres types d’activités…
Comment motiver des gens qui ne sont pas vraiment demandeurs d’une formation ?
L’alphabétisation n’est pas « le remède » à tous les maux et ne doit pas « être prescrite » à tout prix.
Il peut y avoir de bonnes raisons de ne pas s’alphabétiser : ce n’est que si l’on pense que la maitrise de la lecture et de l’écriture va pouvoir effectivement améliorer sa situation que l’on peut décider de s’investir dans l’alphabétisation.
Il s’agit de prendre le temps de comprendre la situation de chaque personne, de voir ce qui est susceptible de lui convenir, de s’interroger avec elle sur la nature des difficultés rencontrées, de l’aider à définir ses priorités et d’identifier les freins qui s’opposent à la réalisation de ses objectifs.
Une personne a-t-elle le droit de refuser de suivre une formation d’alphabétisation qu’on lui propose ?
Oui. Pour Lire et Écrire, suivre une formation en alphabétisation ne peut être qu’un acte volontaire. Il est en effet impossible d’apprendre à lire sous la contrainte.
Cependant, il existe actuellement une forte pression sociale à la formation. De plus, certaines personnes subissent des pressions de la part des CPAS, conditionnant l’octroi de l’aide sociale à la fréquentation d’une formation. Il en va souvent de même auprès de certains services du Forem, d’Actiris et de l’ONEm…
Dans les cas de refus ou de résistance, le rôle de l’association est de prendre contact avec le « prescripteur » pour engager la discussion entre les différents acteurs concernés.
Des formations
À qui s’adressent les cours d’alphabétisation ?
Les cours d’alphabétisation s’adressent à toute personne de plus de 18 ans, belge ou étrangère, pour autant :
- qu’elle n’ait jamais été scolarisée, ou
- qu’elle ait été scolarisée sans avoir obtenu aucun diplôme, ou
- qu’elle ait été scolarisée sans pour autant maitriser les langages fondamentaux (oral, lecture, écriture, calcul) et savoirs de base attendus à la fin de la sixième année primaire.
Les personnes qui répondent à ces critères et qui parlent le français sont dirigées vers des cours d’alpha pour francophone tandis que les personnes qui ne parlent pas le français et ne maitrisent pas l’écrit dans leur langue sont dirigées vers des cours d’alpha pour non-francophone.
Les personnes scolarisées au-delà de ces critères doivent être orientés vers les cours de français langue étrangère organisés notamment le secteur de l’enseignement pour adultes ; les Belges et les étrangers francophones vers d’autres formations en fonction de leur projet personnel (remise à niveau, formation de base, formation (pré)professionnelle).
À partir de quel âge peut-on suivre une formation d’alphabétisation ?
L’enseignement étant obligatoire jusqu’à 18 ans, les formations s’adressent aux plus de 18 ans.
Par ailleurs, plusieurs associations d’alphabétisation organisent également des écoles de devoirs et participent à des projets d’appui scolaire.
Est-ce comme à l’école ?
Lire et Écrire propose des formations basées sur une pédagogie adaptée aux adultes : l’alphabétisation populaire.
Lire et Écrire développe une approche pédagogique respectant les personnes, suivant leur rythme d’apprentissage, prenant en compte leur histoire individuelle et collective, liée aux problèmes qu’elles ont à affronter dans leur vie quotidienne, favorisant la solidarité, le respect des différences, l’autonomie et la participation à la transformation des rapports sociaux, économiques, politiques et culturels en rapports justes et égalitaires.
- Le plus souvent, les formations se déroulent en groupes d’environ 15 personnes.
- Ces groupes peuvent être organisés de diverses manières : en fonction d’un projet, du niveau de connaissance…
- Il n’y a pas de programme préétabli, les formateurs s’adaptant aux projets et besoins de chacun.
- Les apprentissages sont basés sur les expériences vécues par les membres du groupe et leurs centres d’intérêt.
- Les supports, outils et démarches utilisés sont variés.
Quelles sont les activités proposées aux apprenants ?
L’offre de formation varie d’une association à une autre. On peut y retrouver des formations centrées sur l’expression orale, la lecture, l’écriture, les mathématiques, les TIC. Des activités variées sont aussi proposées telles que : ateliers d’écriture, arts plastiques, théâtre, visites culturelles, histoire, vie sociale…
Avec une bonne méthode, n’importe qui pourrait-il alphabétiser ?
Non. Aucun manuel tout fait ne peut permettre d’alphabétiser. Être formateur ce n’est pas appliquer des recettes mais être capable de construire ses outils et d’adapter sa méthodologie en fonction du public. Cela nécessite une formation spécifique, des capacités relationnelles et pédagogiques, un questionnement et une recherche permanente.
Cette approche est développée dans le cadre de référence pédagogique de Lire et Écrire Balises pour l’alphabétisation populaire.
Combien de temps faut-il pour apprendre à lire et à écrire à l’âge adulte ?
Ce temps est variable en fonction de chaque personne et peut dépendre de nombreux facteurs tels que :
- le niveau de connaissance préalable,
- le rythme d’apprentissage,
- la disponibilité, le nombre d’heures de formation par semaine, le travail effectué ou non à domicile,
- l’âge, l’histoire personnelle, la motivation, le projet de la personne,
- l’adéquation du modèle pédagogique et des outils utilisés par le formateur.
L’apprentissage de la lecture et de l’écriture est particulièrement complexe. Il met en jeu de multiples éléments et de nombreux savoirs.
Rappelons qu’un enfant de 6 ans qui rentre en 1re primaire, en maitrisant tous les nombreux prérequis nécessaires, va bénéficier chaque année de 400 heures de cours centrés sur la lecture et l’écriture. Et qu’un adulte qui suit 4 heures de cours par semaine, pendant un an, bénéficie de 160 heures de cours au maximum…
En quoi l’alphabétisation est-elle une action d’Éducation permanente ?
L’alphabétisation est un outil d’émancipation et s’inscrit dès lors dans le champ de l’Éducation permanente, si l’on considère que :
- l’alphabétisation n’est jamais une fin en soi. Il s’agit toujours d’apprendre à lire pour… pour aider les enfants, pour trouver du travail, pour sortir de chez soi, pour entrer dans la société, mais aussi pour se débrouiller seul, pour être libre, pour mieux comprendre le monde, pour savoir se défendre ;
- alphabétiser c’est donner des outils – parmi d’autres – pour comprendre le monde, pour s’y situer, pour développer ses capacités d’analyse et de réflexion critique, pour y agir socialement, économiquement, culturellement et politiquement ;
- alphabétiser c’est aussi vouloir que tous puissent exercer leur droit d’apprendre, c’est-à-dire, le droit de lire et d’écrire, le droit de questionner et de réfléchir, le droit à l’imagination et à la création, le droit de lire son milieu et d’écrire l’histoire, le droit d’accéder aux ressources éducatives, le droit de développer ses compétences individuelles et collectives… ;
- l’alphabétisation suppose le non-enfermement dans des situations d’exclusion car elle implique la pleine participation de tous, participation qui est à la fois le but et la condition de l’apprentissage. C’est dans le courant d’alphabétisation populaire que s’inscrit Lire et Écrire.
L’alphabétisation, est-ce comme une formation au Forem ou à Bruxelles Formation ?
L’alphabétisation s’adresse à tous les publics et pas exclusivement aux demandeurs d’emploi. Le but de l’alphabétisation – acquérir les savoirs de base – concerne en effet un public beaucoup plus large que celui de l’insertion socioprofessionnelle. Les modes d’organisation des associations sont très variés et très souples pour s’adapter au mieux aux demandes et aux besoins du public.
L’alphabétisation est cependant reconnue comme un élément du parcours d’insertion des demandeurs d’emploi analphabètes.
Le Forem (en Wallonie) et Bruxelles Formation reconnaissent donc certaines associations d’alphabétisation comme centres d’insertion socioprofessionnelle (CISP en Wallonie) ou organismes d’insertion socioprofessionnelle (OISP à Bruxelles). Les formations d’alphabétisation pour demandeurs d’emploi, organisées par ces associations, sont alors soumises aux règlementations et décrets des Régions sur l’insertion socioprofessionnelle.
Trouve-t-on plus facilement du travail après la formation ?
L’alphabétisation peut effectivement aider à (re)trouver du travail, appuyer les démarches de recherche d’emploi, même s’il ne s’agit pas d’apprendre un métier.
L’alphabétisation peut aussi permettre d’accéder à des (pré)formations professionnelles. Il existe des formations concomitantes organisées par Lire et Écrire qui combinent cours d’alpha avec en parallèle l’apprentissage d’un métier (maçonnerie, aide-ménagère, boucherie).
Pour ceux qui ont déjà un emploi, l’alphabétisation peut aussi permettre d’en assurer le maintien, d’exercer de nouvelles responsabilités ou de suivre les évolutions technologiques au sein de l’entreprise.
Après l’alphabétisation, y a-t-il d’autres formations ?
Pendant ou après une formation en alphabétisation, les personnes qui le souhaitent devraient pouvoir trouver la formation qu’elles désirent, que ce soit dans le cadre d’une AFT, d’un CISP ou OISP, de l’Enseignement pour adultes, de l’IFAPME, du Forem, de Bruxelles Formation, d’associations d’Éducation permanente, etc.
Nous constatons que, malgré le soutien des associations d’alphabétisation, l’accès à une autre formation est parfois très difficile en raison, notamment, d’une offre insuffisante et de l’augmentation du niveau de compétences exigées.
Combien y a-t-il de personnes dans les groupes ? Y a-t-il des cours individuels ?
Le plus souvent, les formations se donnent en groupe. La dynamique d’un groupe – avec tout ce qu’elle
comporte d’échanges, d’écoute, de solidarité… – est importante dans le processus d’apprentissage.
La taille des groupes peut varier de 4 à 15 apprenants.
Il existe également des formules de travail individuel et personnalisé en complément du travail de groupe ou pour répondre à certains cas spécifiques.
Y a-t-il des cours pour les Belges d’origine ?
De manière générale, les formations ne sont pas organisées sur base de la nationalité ou de la langue d’origine. Nous pensons en effet que la mixité constitue un enrichissement humain et culturel appréciable.
Bien sûr, il n’y aura pas de Belges dans un groupe d’alpha pour non-francophones et il pourra y avoir une majorité de Belges dans un groupe d’apprentissage de la langue écrite.
On constate que les personnes qui ont été à l’école en Belgique ont souvent beaucoup de difficultés à franchir la porte d’un cours d’alphabétisation, difficultés parfois renforcées par le fait de se retrouver isolé au sein d’un groupe composé d’immigrés.
Aussi, certaines associations, particulièrement attentives à cette situation, mettent en place diverses initiatives pour faciliter leur participation.
Est-ce que ce sont des enseignants qui donnent cours ?
Une enquête [2] réalisée en Fédération Wallonie-Bruxelles montre qu’être formateur en alphabétisation est perçu par ceux qui l’exercent comme un métier spécifique auquel une formation d’enseignant ne prépare pas.
Il n’existe pas de formation initiale pour les formateurs en alphabétisation. Aussi, leurs premières formations sont diverses. La majorité d’entre eux ont un diplôme à orientation pédagogique ou psychosociale.
Quel que soit le diplôme de départ, enseignant ou non, les formateurs suivent ou devraient suivre des formations spécifiques au métier de formateur en alphabétisation.
Quelles sont les formations organisées pour les formateurs en alphabétisation ?
Lire et Écrire et d’autres associations organisent des modules de formation de base et de formation continuée spécifique, de durées diverses (de 12 à plus de 120 heures en fonction des objectifs et du contenu).
Le secteur de l’enseignement pour adultes dont dépend l’institut Roger Guilbert organise une formation de formateur en alphabétisation d’une durée de 1 200 heures, permettant d’obtenir un Brevet d’enseignement supérieur (BES).
Y a-t-il des formateurs bénévoles ?
Les bénévoles permettent aussi d’élargir l’offre et d’ainsi mieux répondre à la demande.
Le bénévolat a toute sa raison d’être car il apporte un plus aux actions d’alphabétisation en permettant à des citoyens de s’impliquer dans une action collective.
Mais le bénévolat ne doit pas conduire à désengager les pouvoirs publics de leurs responsabilités. L’alphabétisation est un droit essentiel dont le financement doit être supporté par l’État.
Comme les formateurs salariés, les bénévoles sont vivement encouragés à suivre des modules de formation.
Combien y a-t-il de formateurs ?
En 2010, dernier chiffre disponible sur cette question, 1 414 personnes se sont impliquées dans les actions d’alphabétisation, dont 863 qui ont exercé des fonctions pédagogiques.
515, soit 36 % de ces personnes, sont bénévoles. 94 % d’entre elles travaillent comme formateurs.
Cependant, les bénévoles travaillant souvent à temps réduit, leur temps de travail représente 2 502 heures de prestation par semaine soit 10 % du temps total.
Y a-t-il des formations d’alphabétisation partout en Belgique ?
En 2018, on recense 226 opérateurs d’alphabétisation sur l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles (110 à Bruxelles et 116 en Wallonie). Il s’agit d’associations et de services parapublics. Il faut y ajouter l’offre de formation des 74 établissements de l’enseignement pour adultes susceptibles de s’adresser à un public pas ou peu scolarisé, répertoriés sur le même territoire (15 à Bruxelles et 59 en Wallonie).
À Bruxelles, des formations sont offertes dans toutes les communes. En Wallonie, l’offre est surtout présente en zone urbaine et moins développée dans les communes rurales.
En Flandre, il existe 13 centres de formation de base, organisant au besoin des cours délocalisés, subsidiés par le ministère régional de l’Éducation.
Comment les candidats apprenants sont-ils accueillis et orientés par Lire et Écrire ?
Chaque personne est reçue en entretien particulier. Elle est orientée vers le groupe le plus adapté à sa demande et à ses besoins, en tenant compte des places disponibles dans les associations ainsi que des contraintes d’horaire, de déplacement…
S’il s’avère que l’offre de formation ne correspond pas au projet de la personne, une orientation vers un autre organisme lui est habituellement proposée.
Peut-on s’inscrire à tout moment ?
L’accueil et l’inscription sont possibles à tout moment. Les formations débutent en septembre et en janvier. Dans certaines associations, l’entrée peut s’effectuer tout au long de l’année, en fonction des places disponibles.
Est-ce gratuit ?
Oui. Sauf auprès de certaines associations qui demandent une participation modique aux frais.
En fonction de leur statut, certaines personnes peuvent aussi bénéficier d’une allocation de formation (2 euros par heure suivie) et d’une prise en charge de leurs frais de déplacement (voir plus bas).
Y a-t-il des services de crèche-garderie pour les enfants dont les parents suivent une formation ?
La plupart des associations n’organisent pas elles-mêmes un service de garderie pour les enfants. Certaines travaillent en partenariat avec d’autres services organisant la garde d’enfants. Mais, le plus souvent, c’est aux parents à trouver une solution pour la garde de leurs enfants.
En Wallonie, si l’apprenant a un contrat de formation avec le Forem, il pourra bénéficier d’une intervention financière dans les frais de garderie. Ceci n’est pas le cas à Bruxelles.
Comment les formations sont-elles organisées, selon quels horaires et quelle durée ?
Chaque association possède sa propre organisation. On relève néanmoins quelques constantes :
- Les horaires de cours proposés sont diversifiés pour répondre au mieux aux besoins et aux diverses demandes.
- Les formations peuvent être organisées à raison de 4 à 8 heures par semaine, de 9 à 12 heures, ou de 15 heures et plus.
- Des groupes d’apprentissage sont organisés en fonction des niveaux des personnes ou de projets collectifs (ex : passer son permis de conduire).
- Les cours sont organisés sur base d’une année scolaire, en un ou deux modules.
- Le rythme des formations est généralement aligné sur le calendrier scolaire.
- Les formations ont parfois lieu dans des locaux décentralisés.
- La majorité des associations proposent des cours mixtes et accueillent toutes les nationalités. Cependant certaines associations s’adressent exclusivement à un public féminin.
Obtient-on un diplôme à la fin de la formation ?
En Fédération Wallonie-Bruxelles, seul le ministère de l’Éducation est habilité à délivrer des diplômes.
Les associations peuvent délivrer des certificats ou attestations, dont les modèles peuvent varier d’une association à l’autre.
Cependant tout adulte peut obtenir le Certificat d’études de base (CEB). Ce certificat peut être obtenu de trois manières différentes :
- soit en suivant les modules de l’enseignement pour adultes délivrant ce diplôme,
- soit en présentant l’épreuve organisée par l’inspection de l’enseignement primaire,
- soit en présentant un travail de fin d’études (« Chef-d’œuvre ») devant un jury présidé par un inspecteur. Les associations d’alphabétisation sont habilitées à préparer les candidats à ces épreuves, en partenariat avec l’inspection.
Quand on est inscrit, doit-on suivre obligatoirement tous les cours ?
L’inscription dans toute formation suppose de la part de l’apprenant, un engagement à participer à l’ensemble des activités, à fréquenter régulièrement la formation, à prévenir de ses absences et à les justifier, bref, à mettre tout en œuvre pour que la formation se déroule dans de bonnes conditions.
De son côté, l’association prend également l’engagement de tout mettre en œuvre pour dispenser une formation de qualité.
Peut-on arrêter la formation en cours de route ?
Toute personne est libre d’arrêter la formation quand elle le souhaite parce que, soit elle estime avoir atteint ses objectifs, soit des problèmes personnels l’empêchent de continuer, soit elle n’est pas satisfaite de la formation.
Cependant, pour les personnes qui ont signé un contrat de formation dans le cadre de l’insertion socioprofessionnelle ou dans le cadre d’un suivi par le CPAS, il est nécessaire de respecter l’engagement pris et les procédures prévues.
Peut-on suivre les cours aussi longtemps qu’on le désire ?
À priori oui. On n’a, de fait, jamais fini d’apprendre à lire.
Cependant, sur base d’évaluations régulières, l’association et l’apprenant peuvent décider que celui-ci est arrivé au terme de son parcours au sein de l’association et doit franchir une nouvelle étape. Ils peuvent aussi convenir d’un autre type d’activité ou de formation qui lui conviendra mieux.
Les présences au cours sont-elles contrôlées ?
Chaque association a son propre mode de fonctionnement à ce sujet.
La formation donne-t-elle droit aux allocations familiales ?
Oui, mais uniquement pour les personnes de moins de 25 ans si la formation est étalée sur au moins 5 demi-journées et 15 heures de cours par semaine.
La formation apporte-t-elle un changement au statut de chômeur ? de bénéficiaire du revenu d’intégration sociale ? d’invalide ?
Non. La participation à une formation ne change rien au statut.
Les personnes en incapacité de travail doivent cependant demander une autorisation préalable auprès du médecin conseil.
Pour les demandeurs d’emploi, les dispenses et les conditions à remplir diffèrent selon le type et la durée de la formation. Les formalités à remplir diffèrent également selon le service régional de l’emploi (Actiris, Forem) dont ils dépendent. Aucune dispense n’est en principe accordée lorsque les activités du programme de formation n’atteignent pas au moins 20 heures en moyenne par semaine.
Les personnes en formation continuent-elles à toucher les allocations de chômage, du CPAS, de la mutuelle ?
Oui, les allocations sont toujours payées comme auparavant.
Les apprenants qui suivent les cours dans une association reconnue OISP ou CISP et qui ont signé un contrat de formation avec le Forem ou Bruxelles Formation, bénéficient d’une allocation de formation complémentaire à leurs indemnités, de 2 euros brut par heure de présence au cours.
Les frais de déplacement sont-ils remboursés ?
Pour les apprenants qui suivent les cours dans une association reconnue comme OISP ou CISP et qui ont signé un contrat de formation avec le Forem ou Bruxelles Formation, les frais de déplacement sont remboursés.
Dans certains autres cas, le CPAS rembourse des frais liés à la formation dont les frais de déplacement.
Peut-on suivre une formation en alphabétisation quand on travaille ?
Oui c’est possible, il existe différentes possibilités.
- Si le travailleur désire que son milieu de travail ne soit pas informé de sa volonté d’entrer en formation, il existe des cours organisés en dehors du temps de travail : en soirée ou parfois le samedi matin.
- Si le travailleur a la possibilité d’informer son employeur de sa volonté de se former, il peut bénéficier des avantages du congé-éducation payé qui permettent de suivre la formation en journée et de s’absenter du travail tout en maintenant la rémunération normale payée au moment habituel ; ou de suivre la formation en soirée et de pouvoir récupérer les heures suivies en formation pendant le temps de travail. L’employeur bénéficiera d’un remboursement par heure de congé-éducation prestée pour suivre la formation.
Certaines formations destinées aux travailleurs sont organisées de manière collective, en collaboration avec les organisations syndicales et les employeurs, via des négociations de conventions, ou via une participation d’un fonds sectoriel de formation.
Est-ce que venir en formation peut entrainer des ennuis ?
Non.
Cependant, pour les apprenants qui suivent les cours dans une association reconnue comme OISP ou CISP et qui ont signé un contrat de formation avec le Forem ou Bruxelles Formation, il est important de veiller à bien assurer tous les suivis administratifs nécessaires, notamment auprès des organismes payeurs, en vue d’éviter des difficultés et des retards de paiement.
De plus, pour ces apprenants, il importe de respecter le contrat signé, notamment en ce qui concerne les procédures de rupture de ce contrat.
Peut-il arriver de refuser quelqu’un ou d’exclure une personne des cours ?
Les associations sont à priori ouvertes à toute personne, sans discrimination.
Des personnes peuvent cependant être « refusées », et seront alors réorientées dans la mesure du possible :
- s’il n’y a pas de place ;
- si, après l’entretien d’accueil, il s’avère que l’offre de l’association ne répond pas à la demande de la personne (niveau trop élevé, etc.) ;
- s’il s’avère que la personne n’est pas prête à accepter les règles de fonctionnement de l’association (telles que le travail en groupe, la mixité, etc.)
Même si toute exclusion est un échec, il peut effectivement arriver qu’un opérateur soit amené à mettre fin à la formation d’une personne qui ne respecterait pas les règles de civilité élémentaires (vol, violence…) ou dont les problématiques ne peuvent être prise en charge par l’association (assuétudes, handicap…). Le plus souvent, l’opérateur a défini ces conditions dans un règlement.
En savoir plus
Où peut-on trouver des informations supplémentaires ?
En Fédération Wallonie-Bruxelles
Plusieurs sites web nourris par des opérateurs d’alphabétisation ou les pouvoirs publics en charge de la question :
- Lire et Écrire
- Comité de pilotage permanent sur l’alphabétisation des adultes
- Répertoire associatif bruxellois de l’Alphabétisation et du FLE
Lire et Écrire édite une lettre électronique d’information mensuelle à l’intention des acteurs et sympathisants du secteur. Vous pouvez vous y abonner en pied de chaque page de notre site.
Lire et Écrire édite le Journal de l’alpha quatre fois par an pour informer les intervenants du secteur et susciter des débats pédagogiques et politiques liés à l’alphabétisation des adultes : (presque) tous les numéros ou version en ligne (numéros les plus récentes).
Lire et Écrire a publié un Cadre de référence pédagogique pour l’alphabétisation populaire, téléchargeable.
Chaque année, dans le cadre de l’accord de coopération sur l’alphabétisation des adultes conclu entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, le Comité de pilotage permanent sur l’alphabétisation des adultes édite un État des lieux de l’Alphabétisation en Fédération Wallonie-Bruxelles. On y trouve de multiples informations sur les actions d’alphabétisation, leurs enjeux et l’analyse des politiques menées. On peut aussi y lire la présentation d’initiatives spécifiques et l’analyse des enjeux et des politiques menées, etc. Ces brochures sont téléchargeables sur le site du Comité de pilotage sur l’alphabétisation des adultes.
En Flandre
Ligo (nouvelle appellation de l’ancienne Fédération des centres d’éducation de base) dispose d’un site documenté.
Dans les pays francophones industrialisés
En France : Agence nationale de lutte contre l’illettrisme.
En Suisse : association Lire et Écrire.
Au Québec : Co-Savoir (centre de documentation).
Dans le monde
L’Unesco a créé un portail de l’Alphabétisation.
On y trouve de nombreux documents sur l’analyse de l’analphabétisme dans le monde, les statistiques internationales, les enjeux de l’alphabétisation, la présentation et l’analyse des politiques et des orientations pédagogiques, et de nombreuses recherches dans le domaine.
Et plus…
Pour vous aider dans vos recherches et découvrir une documentation riche et détaillée, le Centre de documentation du Collectif Alpha vous ouvre ses portes et son site web.
Si une de vos questions n’a pas trouvé de réponse…
N’hésitez pas à nous contacter.