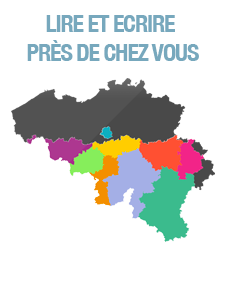Par Antoine Daratos,
Lire et Écrire Communauté française, 2017.
Résumé
Comme de nombreuses autres associations, Lire et Écrire constate une évolution du secteur associatif qui laisse craindre une marchandisation croissante du « non-marchand » : les financements publics sont des plus en plus octroyés via des « appels à projet » qui placent les associations dans la position de fournisseurs de services, plutôt que d’acteurs possédant une expertise sur une problématique sociale et sur les moyens d’y répondre. La marchandisation tendrait donc à faire passer les subventions publiques d’un statut de soutien à l’action associative existante à une rémunération en échange d’une mission effectuée pour les pouvoirs publics, en fonction de priorités (changeantes) de ceux-ci. Pour l’alphabétisation, cela signifie qu’une plus grande marchandisation du secteur aurait pour conséquence l’incorporation d’impératifs tels que l’activation et la catégorisation des publics, une exigence inadaptée en termes de résultats de l’apprentissage, et une insécurité financière grandissante.
Si de nombreux facteurs contribuent à cette évolution vers une marchandisation du non-marchand en Belgique (voir notamment le projet de réforme du droit des sociétés en cours d’élaboration), il semble important d’examiner le contexte règlementaire européen qui encadre les subventions publiques aux opérateurs non marchands. On sait en effet que l’Union européenne promeut, via sa législation, la généralisation des principes du marché et de la libre concurrence.
De fait, un premier examen du droit européen confirme cette intuition. Ainsi, la notion belge de « non marchand » n’y a aucune existence, et l’ensemble des acteurs associatifs doivent être considérés comme des « entreprises », fournissant des services « économiques » dans un « marché ». Il en découle qu’a priori, l’interdiction faite par l’UE aux États de subventionner des acteurs privés (sous la forme d’« aides d’État ») s’applique également aux associations du non marchand, à moins que les financements ne soient octroyés sur base d’un marché public ou « au prix du marché ».
Cependant, il existe une dérogation possible pour les « services sociaux d’intérêt général », comprenant notamment les services visant à « l’inclusion sociale des groupes vulnérables », ainsi que pour les subventions ne dépassant pas la somme de 500 000 euros sur trois exercices fiscaux. La règlementation européenne n’interdit donc aucunement le subventionnement des acteurs du « non marchand », mais modifie le contexte légal dans lequel celui-ci prend place : les subventions relèvent désormais d’un régime d’exception par rapport à la règle générale, qui veut qu’un financement public soit octroyé de manière beaucoup plus restrictive. Un tel contexte ne contraint pas les pouvoirs publics à modifier les régimes de financement des opérateurs, mais il offre un cadre dans lequel il devient extrêmement facile de libéraliser un secteur d’activité jusque-là protégé. Il suffit en effet qu’un pouvoir public décide de ne pas avoir recours à la législation européenne autorisant les subventions aux services sociaux, et passer « commande » de tels services via une procédure de marché public, pour qu’on se trouve face à une modification du statut du financement, et donc de la nature du secteur.
Notons cependant encore que, dans le cas où un pouvoir public opte pour le recours à une procédure de marché public, la directive européenne sur les marchés publics l’autorise à avoir recours à une procédure allégée dans le cas des services « sociaux ». Cette procédure n’est pas aussi contraignante, en termes des critères de sélection dont il faut tenir compte, qu’une procédure complète applicable au secteur privé « classique ». Toutefois, une telle procédure comporte tout de même l’obligation du respect des principes de publicité de l’offre et de l’égalité de traitement des opérateurs. De plus, et surtout, ici comme pour les subventions, les pouvoirs publics ont simplement la possibilité, et non l’obligation, d’avoir recours à la procédure allégée.
La législation européenne, si elle n’impose aucune obligation aux pouvoirs publics en termes de libéralisation de l’action associative, offre tout de même un contexte très favorable à celle-ci si les États souhaitent l’exploiter, que ce soit pour des raisons d’ordre idéologique, budgétaire, politique, ou pour se mettre à l’abri de toute contestation éventuelle concernant les financements qu’ils octroient.
Face à cette réalité, il conviendrait, pour les opérateurs du non marchand, de se mobiliser pour qu’il soit fait effectivement usage des dispositions du droit européen qui garantissent la légalité des subventions aux services sociaux. Ainsi, il « suffirait », pour que ce soit le cas, que le texte de loi européen concerné soit cité dans les législations encadrant des subventionnements ou, à défaut, dans les décisions individuelles d’octroi de subvention. Or, en Belgique francophone, le flou est encore trop souvent entretenu sur cette question, pourtant centrale pour le modèle d’action du secteur non marchand.
Introduction
Alors que les subsides publics structurels, permanents, destinés au secteur associatif, diminuent de manière continue [1], on assiste aujourd’hui à une généralisation d’une relation de (quasi ?)-marché de type « client/fournisseur » entre les pouvoirs publics et les associations, avec une place croissante réservée aux appels à projets pour financer l’action sociale. Selon Jacques Moriau, Il ne s’agit plus de reconnaitre et de financer des initiatives émergeant d’acteurs indépendants ayant la volonté de répondre aux demandes du terrain selon un cadre de référence spécifique, mais de déterminer les problématiques, les territoires et les populations cibles qui doivent être abordés selon les dimensions privilégiées par les instances politiques dans un appel à projet.
[2] Ce nouveau rapport de sous-traitance entraine plusieurs conséquences : les acteurs associatifs sont moins à même de définir eux-mêmes les problèmes et les solutions les plus adaptées pour agir, les opérateurs sont mis en concurrence dans le cadre de ce qui s’apparente de plus en plus à un « marché associatif » (ou à des marchés dans lesquels ils sont présents avec d’autres acteurs, p. ex. un « marché de la formation »), les pouvoirs publics augmentent leur mainmise sur le fonctionnement du secteur (définition des missions, mais aussi du mode de gestion et de pilotage des projets). La logique des appels à projets limite donc la capacité d’innovation des associations en faveur d’une catégorisation à outrance des actions et des projets (et donc des publics). Enfin, les priorités variant en fonction de l’agenda médiatique et politique, une telle logique est facteur de précarisation et d’incertitude financière pour les associations [3].
Ces évolutions peuvent bien entendu être expliquées par de nombreux facteurs, comme une volonté de la part du politique de mieux contrôler le secteur : un système d’appels d’offre ouverts à tout acteur est plus malléable qu’un ensemble d’opérateurs bénéficiant de financements stables pour des priorités ou des logiques d’action qu’ils ont largement façonnées eux-mêmes. Il est cependant intéressant, afin de compléter le tableau des différentes dynamiques à l’œuvre, de se tourner vers les règlements européens qui contribuent à favoriser et à étendre le champ d’application du principe de la « libre concurrence », principe qui gouverne aujourd’hui le chantier européen d’un grand « marché unique ».
En effet, plusieurs instruments encadrent les possibilités d’action et d’intervention des pouvoirs publics dans les domaines économique et social. D’abord, la directive Services instaure la « liberté d’établissement » des entreprises partout dans l’UE. Ensuite, les règles sur les « aides d’État » interdisent ou encadrent le soutien financier des entreprises privées par les pouvoirs publics. Enfin, les règles sur les marchés publics régissent la manière dont les États doivent attribuer aux acteurs privés les missions financées par de l’argent public. Ces règlementations semblent bien techniques mais l’enjeu est également politique : il y va de la possibilité, pour les États (et, nous le verrons, de leur volonté) d’organiser l’action publique, que ce soit par leurs propres moyens, soit en délégant des missions de service public à d’autre organismes, ou encore en finançant des acteurs compétents actifs dans des domaines comme la santé, l’économie sociale, l’éducation, la formation ou la culture. Si cette possibilité, comme nous allons le voir, n’est pas supprimée, elle est largement encadrée, contrainte et inscrite dans un nouveau rapport de forces défavorable aux opérateurs associatifs. Ce nouveau cadre permet en effet aux pouvoirs publics de subventionner des services dits « sociaux », mais jette par ailleurs les bases d’une marchandisation à laquelle les pouvoirs publics n’ont plus qu’à donner leur assentiment.
Les services publics, le non marchand et les services d’intérêt général
On peut s’étonner que ces règlementations, qui paraissent relever du marché et de l’activité des entreprises, puissent s’appliquer au secteur non marchand. Cela s’explique par le fait que le droit européen requalifie entièrement les acteurs par un vocabulaire totalement différent de celui utilisé au niveau national, ce qui modifie aussi complètement la perception des enjeux. Ainsi, les notions de « services publics » et de « non marchand » n’existent pas en droit européen ! Celui-ci utilise l’expression de « services d’intérêt général », qu’on peut décomposer en deux catégories :
- Les services non économiques d’intérêt général (SNEIG)
- Les services d’intérêt économique général (SIEG)
Seuls les services dits « non économiques » sont exclus des règlementations sur les services, les aides d’État et les marchés publics. Cependant, il n’existe pas de liste exhaustive ni de définition précise de ces services, l’UE ayant opté pour le maintien du flou sur cette question. C’est donc l’appréciation de la Cour de justice européenne [4] qui permet d’approcher une définition concrète de cette catégorie. Le critère qu’elle utilise est le fait que le service soit ou non fourni sur un marché ou en échange d’une rémunération. Attention : cette rémunération ne doit pas obligatoirement être fournie par les personnes qui bénéficient de ce service. Dès lors, les activités considérées comme « non-économiques » sont celles qui relèvent des compétences de base, régaliennes, des États :
- Activités relatives à l’armée ou à la police
- Sécurité de la navigation aérienne, contrôle de la circulation maritime
- Surveillance antipollution
- Mise en œuvre du système carcéral
-
Gestion sous le contrôle de l’État de régimes de sécurité sociale obligatoire poursuivant un objectif exclusivement social, fonctionnant selon le principe de solidarité, offrant des prestations d’assurance indépendantes des cotisations et des revenus de l’assuré
. [5]
La définition de ce qui relève du « non économique » est donc beaucoup plus restrictive que ce que l’on pourrait imaginer. Parmi les services ayant été jugés « économiques » par la Cour européenne de justice, on peut citer de nombreuses activités à caractère social, et s’étonner de les voir qualifier d’« économiques » :
- Services de transport d’urgence et des malades
- Gestion des infrastructures de transport
- « Le logement à loyer modéré » :
allocation de fonds de prêts immobiliers, régimes de subventions de loyers visant à fournir des logements à couts réduits, régimes de subvention de loyers et de systèmes de subvention pour les personnes âgées et handicapées ainsi que les ménages socialement défavorisés
[6] - L’activité de placement exercée par des offices publics pour l’emploi
- Des régimes d’assurance facultatifs, où les prestations d’assurance dépendent uniquement du niveau de cotisations payées par les bénéficiaires et des résultats financiers des investissements réalisés.
On le voit, des activités de nature « sociale » sont considérées par l’UE comme « économiques ». Les catégories européennes ne reconnaissent aucune pertinence à la notion belge de « non marchand ». De même, le statut de l’entité en droit interne (ASBL, etc.), ou le fait que l’entité ait été créée à des fins lucratives ou non, ne sont pas des critères pertinents du point de vue européen : des ASBL belges sont donc considérées, en droit européen, comme des entreprises « comme les autres », auxquelles doivent s’appliquer les mêmes règles que pour le secteur marchand !
L’Union européenne parle d’ailleurs dans plusieurs textes de « services sociaux d’intérêt général », sans que cela implique automatiquement que ces services soient reconnus comme non économiques. Or, on compte parmi eux, selon la définition que l’UE en donne, les régimes légaux et complémentaires de protection sociale et les autres services essentiels prestés directement à la personne. Ces services jouant un rôle de prévention et de cohésion sociale, ils apportent une aide personnalisée pour faciliter l’inclusion des personnes dans la société et garantir l’accomplissement de leurs droits fondamentaux
[7].
Cependant, bien qu’ils soient plus étroitement associés au secteur marchand, les services dits « d’intérêt économique général », et donc parmi eux certains services dits « sociaux », bénéficient tout de même d’un statut particulier. Ce statut est reconnu à plusieurs endroits du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la base juridique de l’UE. Il souligne notamment le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales, et locales
pour mettre en place de tels services, et l’importance de la qualité
, du caractère abordable
et de la promotion de l’accès universel et des droits des utilisateurs
[8].
La directive Services
Les règlementations étudiées ici obéissent toutes à cette dynamique : (1) remise en cause globale des statuts et des règlementations, et (2) instauration d’un régime d’exceptions permettant, sous certaines conditions, le maintien des financements étatiques. La directive Services, par exemple, vise à libéraliser l’activité économique en permettant aux entreprises européennes de s’établir dans n’importe quel pays de l’UE sans pouvoir en être empêchées par l’État choisi, ce qui diminue fortement la capacité des pouvoirs publics de contrôler la composition des secteurs d’activités présents sur leurs territoires. Le texte devait à l’origine concerner l’ensemble des services sans distinction, mais a fait l’objet de nombreux amendements suite aux importantes contestations pointant les risques de libéralisation et de marchandisation de secteurs protégés.
Ainsi, l’article premier stipule que La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit communautaire, ce qu’ils entendent par services d’intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d’État ou les obligations spécifiques auxquelles ils doivent être soumis
. L’article 2 exclut explicitement du champ de la directive les services d’intérêt général non économiques [et] les services sociaux relatifs au logement social, à l’aide à l’enfance et à l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par l’État, par des prestataires mandatés par l’État ou par des associations caritatives reconnues comme telles par l’État
.
Concrètement, les services sociaux sont donc exclus du champ de la directive si (1) ils sont fournis par l’État, (2) par des prestataires mandatés par l’État ou (3) par des « associations caritatives » reconnues comme telles par l’État. Malgré le caractère peu précis, dans le contexte belge, d’expressions comme « associations caritatives » ou « mandat » [9], on peut considérer que sont protégées les associations du non-marchand financées par les pouvoirs publics afin de remplir des missions de services sociaux.
Plus de précision aurait néanmoins été souhaitable. Malheureusement, lors de la transposition de la directive en droit belge, les pouvoirs publics n’ont pas cru bon de préciser ces notions étrangères au droit belge pour définir précisément les secteurs d’activités exclus du champ de la directive, mais se sont largement contentés de reprendre la formulation européenne. Ainsi le décret de la Région wallonne du 10 décembre 2009 stipule que :
§1er. Le présent décret s’applique, sans préjudice des compétences de l’autorité fédérale, des régions et des communautés qui ne sont pas transférées à la Région wallonne en vertu de l’article 138 de la Constitution, aux services, à l’exception :
- 1o des services d’intérêt général non économiques, y inclus les services sociaux ;
- (…)
- 4o des services de soins de santé, qu’ils soient ou non assurés dans le cadre d’établissement de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés ou de leur nature publique ou privée ;
- 5o des activités participant à l’exercice de l’autorité publique conformément à l’article 45 du traité CE ;
- 6o des services sociaux relatifs au logement social, à l’aide à l’enfance et à l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par la Région wallonne et les autres autorités publiques, par des prestataires mandatés par la Région wallonne ou par des associations caritatives reconnues comme telles. [10]
En dépit du caractère assez lâche et ambigu des protections accordées aux services sociaux d’intérêt général, la directive Services n’a jusqu’à présent pas provoqué la libéralisation à outrance que l’on aurait pu attendre, et l’on peut considérer que le non-marchand belge est couvert par les clauses existantes. Cependant, la directive Services n’est qu’un des éléments d’un arsenal législatif européen promouvant les mécanismes de marché et limitant la place de l’action publique, et elle ne concerne pas la question des subventions qui peuvent être accordées par les pouvoirs publics aux acteurs (mais uniquement celle de l’autorisation de prester). Concernant cette question, il faut se tourner vers la règlementation sur les « aides d’État ».
Les « aides d’État »
En effet, le principe de base de l’Union européenne en matière de subvention d’entreprises par les États est l’encadrement strict de ce que le droit européen appelle des « aides d’État », c’est-à-dire des financements ou subventions accordées par les pouvoirs publics à des acteurs privés. Ces financements sont considérés par l’Union européenne comme potentiellement nuisibles car ils interfèreraient avec le « libre fonctionnement » du marché européen. L’UE part donc de la prémisse selon laquelle le marché privé doit avoir priorité sur l’action publique, laquelle ne doit pas intervenir dans son fonctionnement car elle nuirait alors à son efficacité : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions » [11].
Les États sont tenus d’informer la Commission européenne des aides qu’ils accordent à des opérateurs économiques. La Commission, si elle juge les aides incompatibles avec le droit européen, peut ouvrir une procédure pour les faire supprimer ou modifier.
Cependant, comme pour la directive Services, la possibilité est laissée ouverte que certaines aides ne soient pas concernées par cette règlementation – il s’agit des aides fournies aux entreprises chargées de la gestion de services économiques d’intérêt général (SIEG – ceux-ci s’opposent aux services non-économiques d’intérêt général, qui sont la prérogative des États, voir ci-dessus).
Les quatre critères « Altmark »
Ces règles, exposées dans le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ont été précisées par la Cour européenne de justice dans son arrêt « Altmark » (2003), et plus récemment par la Commission européenne dans le « paquet sur les aides d’État en faveur des SIEG », dit « paquet Almunia » [12] (2012 – un guide reprenant des questions fréquentes (FAQ) a également été publié [13]). Ces textes ont défini quatre critères qui permettent d’établir qu’une compensation accordée à une entité n’est pas une aide d’État, et est donc légale aux yeux du droit européen. Ces quatre critères doivent être réunis dans chaque cas :
- Existence d’un service d’intérêt économique général : l’entreprise doit être effectivement chargée d’une obligation de service d’intérêt général. De même que pour le caractère « économique » ou non des services (voir ci-dessus), il n’existe pas de règlementation qui définit cette notion de manière claire et définitive. Ce sont les États membres qui disposent donc d’un large pouvoir d’appréciation quant à la définition de ce qu’ils considèrent comme un SIEG [14]. Notons quand même que ces missions de service économique d’intérêt général concernent des services qu’un opérateur n’assumerait pas (ou pas dans les mêmes conditions) s’il considérait son propre intérêt commercial [15]. Par ailleurs, cette marge de manœuvre laissée aux États, si elle peut être considérée comme positive, est à double tranchant, les autorités publiques n’étant pas contraintes d’offrir une protection maximale aux opérateurs de SIEG. Ainsi, comme on l’a vu plus haut, dans le cas de la transposition de la directive Services, la Région wallonne est restée très floue quant à la définition de « services sociaux » pouvant être exclus du champ de la directive.
- Existence d’un mandat : la mission de service public doit être confiée par un acte législatif ou règlementaire ou un contrat, fixant au préalable le contenu et la durée de la mission, de même que les paramètres de la compensation.
- Non surcompensation : la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir les couts occasionnés par le service en question.
- Sélection du prestataire : se fait a) par appel d’offre dans le cadre d’une procédure de marché public ou b) en déterminant la compensation sur base de ce dont
une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens nécessaires
aurait besoin pour fournir ce service. Ce deuxième scénario n’est pas facilement exploitable, les États devant pouvoir justifier le cout de référence préétabli qu’ils utilisent : ce coutrésulte d’une origine fiable, est basé sur des données solides et correspond aux valeurs du marché
[16]. Exemple : la rémunération versée à Poste italiane pour la distribution de produits d’épargne, inférieure aux montants versés pour des produits similaires existant sur le marché. Ce dernier critère constitue donc un fort incitant à recourir à des procédures de marchés publics afin de se mettre à l’abri de contestations éventuelles.
Les « aides d’État » autorisées
Si ces quatre critères ne sont pas remplis, cela ne veut pas pour autant dire que les financements sont illégaux. Ils constituent des « aides d’État » aux yeux du droit européen, mais peuvent être acceptables et même échapper à l’obligation d’être signalés à la Commission pour examen. C’est le cas pour les aides aux services dits « sociaux » d’intérêt général, ainsi que pour les aides de minimis.
Les services « sociaux » d’intérêt économique général
Les États peuvent accorder certaines aides ne correspondant pas aux quatre conditions ci-dessus sans pour autant devoir en notifier la Commission. C’est le cas notamment pour les aides ne dépassant pas 15 millions d’euros par ans, et pour les compensations octroyées pour des services répondant à des besoins sociaux concernant les soins de santé et de longue durée, la garde d’enfants, l’accès à la réinsertion sur le marché du travail, le logement social et les soins et l’inclusion sociale des groupes vulnérables
[17].
Cette exemption ne s’applique que si la durée du mandat accordé à l’entreprise est inférieure ou égale à dix ans (avec la possibilité de renouvèlements). Pour qu’elle porte ses effets, l’acte notifiant le mandat doit obligatoirement faire mention de cette règlementation européenne. Par ailleurs, dans ce type de cas, les États doivent être soumis à une obligation de contrôle du respect des conditions imposées dans l’acte (au minimum tous les trois ans et au terme du mandat) et doivent pouvoir, sur demande de la Commission, fournir des éléments de preuve. Enfin, il n’y a ici aucune exigence d’efficience dans le calcul du montant de la compensation : le montant de la compensation ne doit pas nécessairement être défini au moyen d’une procédure de marché public ou d’une comparaison avec les couts d’une entreprise moyenne, bien gérée
[18].
On le voit, cette clause est donc potentiellement protectrice pour une grande partie du non marchand en Belgique. Toutefois, elle demeure largement inexploitée par les pouvoirs publics, qui ne mentionnent cette règle européenne ni dans les décrets, ni dans les décisions ou contrats de subvention. Or, la « référence expresse » est légalement indispensable pour que cette clause puisse prendre effet, comme l’a confirmé la Cour de justice européenne dans un arrêt du 21 juillet 2016 : la condition selon laquelle un régime d’aides, afin d’être exempté de l’obligation de notification prévue à l’article 108, par. 3, TFUE, doit contenir une référence expresse à ce règlement, ne constitue pas une simple formalité, mais revêt un caractère impératif, de sorte que sa méconnaissance fait obstacle à l’octroi d’une exemption de cette obligation au titre dudit règlement
[19]. Il est donc impératif, pour l’ensemble des acteurs bénéficiant de subventionnements, d’insister auprès des pouvoirs publics pour que ce règlement soit mentionné expressément dans toute décision de subvention.
Les aides de minimis
Les aides accordées à des entreprises fournissant un service d’intérêt économique général qui ne dépassent pas 500 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux ne doivent pas être notifiées à la Commission. Si cette exemption couvre de nombreuses associations, il reste qu’il s’agit d’un plafond très bas pour nombre d’autres acteurs.
Les aides d’État à notifier à la Commission européenne
Si une aide attribuée ne correspond à aucun de ces cas de figure, celle-ci doit être notifiée à la Commission européenne qui procèdera à une vérification de sa légalité, selon une série de critères :
- L’existence d’un SIEG
- L’existence d’un mandat précisant les obligations de services publics et les méthodes de calcul de la compensation
- Une durée de mandat « justifiée » (ne devant pas excéder la période nécessaire à l’amortissement comptable des principaux actifs indispensables à la prestation du SIEG)
- Le respect de la directive sur la transparence
- Le respect des règles de l’Union applicables aux marchés publics
- L’absence de discrimination entre entreprises assurant un même SIEG
- Le contrôle de la surcompensation. [20]
Conclusion sur les « aides d’État »
Les règlementations sur les aides d’État ménagent donc des exceptions permettant le financement des services économiques d’intérêt général et des services sociaux, mais elles soumettent les acteurs à des raisonnements juridiques complexes basés sur des notions floues et de multiples exceptions, et ce en l’absence de tout travail de clarification de la part des pouvoirs publics domestiques. De ce fait, et en dépit d’un certain nombre de clauses exploitables, l’insécurité juridique persiste quant à la légalité d’une série de financements aux yeux du droit européen – et cette incertitude peut amener à l’adoption de mesures plus restrictives de la part des acteurs afin de la réduire, comme le recours plus fréquent à des procédures de marchés publics (voir la quatrième condition de l’arrêt Altmark, ci-dessus). Il convient donc d’exiger que les pouvoirs publics aient effectivement recours à la possibilité, laissée ouverte par le droit européen, de subventionner des services sociaux d’intérêt général – et dès lors, qu’il soit fait explicitement mention de cette règlementation dans les législations organisant les secteurs de l’action non marchande ou, à défaut, dans les décisions individuelles de subvention.
S’il est impératif d’être attentif à la clarification du statut des financements perçus, c’est que le droit européen, s’il autorise (comme nous venons de le voir) des subventions, les transforme en un régime d’exception. Il laisse ainsi la possibilité ouverte aux pouvoirs publics de considérer l’octroi d’un financement non pas comme une subvention, mais comme une opération de commande réalisée dans le cadre d’un marché peuplé de fournisseurs. Ainsi, soit que les pouvoirs publics souhaitent libéraliser davantage un secteur d’activité, soit qu’ils souhaitent se mettre à l’abri d’éventuelles contestations basées sur le droit européen, il leur suffit d’avoir recours à un marché public pour que l’on sorte du cadre de la subvention (et de toute la législation sur les aides d’État qui la régit) pour basculer dans un fonctionnement de marché. On quitte alors le champ de la décision 2012/21/UE, qui autorise le financement des services sociaux, et on tombe dans la règlementation sur les marchés publics. Dès lors, on ne se trouve plus dans le cas d’une subvention accordée délibérément par un pouvoir public à un acteur mandaté de manière stable pour fournir un service social ou d’intérêt général donné, mais dans le cadre d’un marché où les acteurs entrent en compétition pour remplir une mission bien précise contre rémunération.
Ce dernier cas de figure est régi dans le droit européen par la directive sur les marchés publics, qui s’applique dès qu’on se trouve dans le cadre d’une « commande ». Le critère déterminant, pour distinguer la subvention de la commande, consiste à identifier l’entité qui conçoit le projet. On aura affaire à un marché public dans le cas d’un projet conçu par les pouvoirs publics puis confié à un opérateur, et à une subvention lorsque c’est l’opérateur qui conçoit le projet plus ou moins librement (c’est donc bien à ce critère qu’il convient de se fier, et non à la dénomination « appel d’offre »/« appel à projet », même si celle-ci le recoupe en grande partie) [21].
La directive sur les marchés publics [22]
La directive sur les marchés publics est d’autant plus centrale que, on l’a vu, le passage par une procédure de marché public est une des manières de rendre un financement public acceptable aux yeux du droit européen (voir, ci-dessus, le point Sélection du prestataire).
Cette directive sur les marchés publics contribue à la révolution dans la manière d’envisager le financement public de services d’intérêt général : les subventions ne sont plus obligatoirement assimilées à des délégations de services publics relevant de décisions politiques prises en vue de l’intérêt commun, mais peuvent aussi être considérées comme des opérations de commande, de sous-traitance de services, qui doivent être règlementées en vue du respect de la libre concurrence [23]. La directive sur les marchés publics précise les exigences auxquelles doivent se conformer de telles commandes passées à des opérateurs privés, afin de garantir une concurrence maximale.
Toutefois, ici comme dans les cas précédents, une série d’exceptions s’appliquent à la règle générale. Ainsi, les « services sociaux » [24] sont soumis à une procédure allégée. Cependant, cette procédure comporte tout de même l’obligation (1) d’émettre un avis de marché informant publiquement de l’existence et de la nature du marché à passer et (2) de faire connaitre les résultats de la procédure de passation de marché au moyen d’un avis d’attribution de marché
(art. 75). De plus, (3) les règles d’attribution de ces marchés doivent respecter les principes de transparence et d’égalité de traitement des opérateurs économiques
.
Outre cette obligation, les États membres sont libres de déterminer les règles de procédure applicables, tant que celles-ci permettent aux pouvoirs adjudicateurs de prendre en compte les spécificités des services en question
. Les États membres, en décidant des règles d’attribution des marchés, doivent également veiller à la nécessité d’assurer la qualité, la continuité, l’accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l’exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d’utilisateurs, y compris les catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l’implication des utilisateurs, ainsi que l’innovation
(art. 76).
Enfin, il faut noter que ces obligations valent pour les marchés de plus de 750 000 euros – les pouvoirs publics préservant une liberté complète pour appels d’une valeur inférieure.
L’État belge a transposé cette directive dans la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (voir en particulier le Titre II, chapitre 6). La loi reprend les exigences et dérogations rendues possibles par la directive. Ainsi, premièrement, elle rappelle les obligations de publication et de respect des principes de transparence, de proportionnalité et d’égalité de traitement des opérateurs économiques. Deuxièmement, lorsqu’il s’agit de services sociaux (dont elle établit la définition dans son annexe III), elle autorise un pouvoir public à recourir à une procédure sui generis avec publication préalable dont il fixe les modalités
(art. 89 §4). Les pouvoirs publics conservent donc une certaine liberté dans la conception de commandes publiques de services sociaux, et ne sont pas tenus de faire jouer la même procédure que pour les autres marchés publics. Cependant, comme pour la directive Services et les règles sur les aides d’État, le financement des services sociaux est construit comme une dérogation par rapport à une règle générale basée sur des mécanismes de marchés. Par ailleurs, au sein de ce régime spécifique pour les services sociaux, on a introduit les « fondamentaux » des mécanismes de marchés publics, à savoir l’exigence d’un avis de marché ou de pré-information public, et le principe d’égalité de traitement des acteurs, quel que soit leur statut, leur histoire ou leur modèle économique.
Conclusion
La constatation centrale, lorsqu’on prend connaissance de la législation européenne en matière de services, d’aides d’État et de marchés publics, a trait au fait que le droit européen ne connait pas la notion belge de « non marchand ». Ainsi, à ses yeux, les acteurs associatifs sont assimilés à des entreprises opérant dans un marché. On assiste donc à la redéfinition juridique, et donc à la dénaturation, de secteurs d’activité entiers comme des « marchés » peuplés d’« entreprises » exerçant des activités « économiques ». Le statut d’un acteur en droit belge (ASBL, etc.) ou le fait qu’il exerce ses activités à des fins non lucratives ne change rien à cette requalification.
Ce point est crucial car, dans le même mouvement, les règles régissant le financement des entreprises privées par les pouvoirs publics s’appliquent, par défaut, aux acteurs du non marchand, comme l’interdiction des aides d’État (si ce n’est via un marché public) ou les règles sur l’organisation des marchés publics. Cependant, le droit européen prévoit des dérogations et des régimes d’exceptions qui permettent aux États de continuer à traiter les opérateurs fournissant des « services sociaux d’intérêt général » de manière plus favorable. Ainsi, la décision 2012/21/UE, à condition qu’elle soit expressément mentionnée dans la législation régissant une subvention ou dans une décision individuelle d’octroi de subvention, autorise un pouvoir public à fournir à des opérateurs des « compensations de service public ».
Les pouvoirs publics peuvent donc continuer à subventionner de manière tout à fait libre les services sociaux d’intérêt général. Toutefois, le fait qu’il s’agisse d’un régime d’exception, à une règle plus générale qui veut qu’on opère par appels passés dans le cadre de marchés publics, ouvre la porte à la marchandisation. La décision de savoir si un financement relève d’une subvention ou d’un marché public revient en effet désormais au pouvoir public bailleur de fonds. Un État souhaitant libéraliser une série de secteurs, acquérir plus de contrôle sur ceux-ci, ou préférant se mettre à l’abri, de manière trop zélée, de toute contestation possible de la légalité des financements qu’il octroie, peut donc opter pour un fonctionnement de marché, via une commande régie par la législation sur les marchés publics [25].
Le droit européen ne contraint donc pas les pouvoirs publics nationaux à libéraliser des secteurs de type non marchand, mais leur offre un cadre législatif dans lequel ceux-ci peuvent aisément œuvrer à la marchandisation d’un secteur. Cette tendance à la libéralisation promue par les textes de l’UE se trouve d’ailleurs dans des textes totalement étrangers à la question des financements, comme le cadre européen des certifications et les cadres « qualités » qui visent entre autres à créer les conditions d’un marché dans le paysage de l’éducation et de la formation [26].
Si nous n’en sommes pas encore là en Belgique francophone, où la plupart des appels laissent encore la part belle à l’opérateur en ce qui concerne la conception du projet, ce contexte légal, combiné à d’autres tendances politiques, comme la volonté de davantage contrôler le secteur associatif, de libéraliser de nouveaux pans de l’économie, ou de réduire les dépenses publiques, pourrait amener à l’érosion progressive du modèle « non marchand » au profit de l’émergence de nouveaux marchés. On suivrait en cela les évolutions en Allemagne, où une grande part des financements publics de formation est octroyée via des procédures de marchés publics, ou en France, où l’idée d’un marché de la formation professionnelle est aujourd’hui bien ancrée.
Par ailleurs, alors que le droit européen ménage la possibilité de garantir la légalité des subventions octroyées aux acteurs du non marchand, il faut déplorer le peu de zèle dont ont fait preuve les pouvoirs publics belges pour « traduire » et mettre en œuvre cette législation dans le droit belge. Compte tenu de la complexité de la législation européenne, le flou entretenu autour de la manière dont elle s’articule en Belgique est source d’insécurité juridique. Ainsi, par exemple, aucune référence n’est faite à ces questions dans les textes législatifs organisant des secteurs de services d’intérêt économique général, comme le décret CISP wallon ou le décret EP de la FWB, ni dans les décisions individuelles d’octroi de subsides et d’agrément – alors même qu’une simple référence au droit européen suffirait à garantir la légalité des subventions octroyées dans le cadre de ces dispositifs.
Enfin, il convient de noter que, même dans le cas de l’usage des clauses autorisant les subventionnements des services sociaux, on assiste à une requalification de l’action associative en mission de service public ou d’intérêt général ce qui suppose (voir la notion de « mandat ») que l’on se place d’emblée dans une logique de délégation et de compensation. Or, cette logique est en inadéquation avec les réalités historiques du développement de l’action associative, mais aussi avec certaines logiques légales concurrentes, comme celle à l’œuvre dans le décret Éducation permanente, qui se veut un soutien à l’initiative associative. La Commission européenne, si elle reconnait l’existence de ces réalités, précise que c’est bien la logique de la délégation par mandat qui doit prévaloir : Le fait que le prestataire de services soit associé au processus conduisant à l’attribution de la mission de service public n’implique pas que cette mission ne découle pas d’un acte de la puissance publique, même si le mandat est établi à la demande du prestataire de service. Dans certains États membres, il n’est pas rare que les autorités financent des services développés et proposés par le prestataire lui-même. L’autorité doit cependant décider si elle approuve ou non la proposition du prestataire avant de pouvoir lui accorder une compensation.
[27] La généralisation des appels à projet – même si, comme on l’a vu, ils ne constituent pas des marchés publics tant que l’opérateur prend un part active dans la conception du projet – peut-être interprétée comme un autre signe de la prévalence de cette conception de l’action associative comme étant une action publique déléguée, devant dès lors obéir à la logique des plans stratégiques, définissant priorités et objectifs chiffrées, dont les autorités européennes et domestiques sont de plus en plus friandes. Enfin, la distinction entre les missions financées et les entités qui les fournissent, qui est poussée à son comble dans ce modèle de délégation, peut éventuellement entrainer un certain nombre de difficultés pratiques pour les opérateurs, censés utiliser les subventions uniquement pour les missions déléguées et en aucun cas pour « eux-mêmes », fusse pour assurer la solidité ou la qualité de leurs prestations à l’avenir.