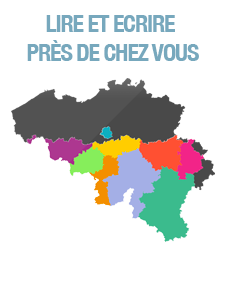Télécharger l’analyse : .pdf - .epub
Peu après mon arrivée chez Lire et Écrire, on m’a proposé de participer au projet Erasmus qui était en cours avec La Brèche et le réseau des Créfad. D’après ce que j’avais compris, le projet visait à partager des outils, des pratiques, des réflexions sur la question de l’écriture, et plus spécifiquement sur celle de l’accompagnement à l’écriture. Dans le contexte de l’éducation populaire, le sujet m’a, au départ, semblé tout à fait évident. Il y avait, je pense, deux raisons à cela.
Pour commencer, je savais que l’éducation populaire et l’écriture étaient historiquement liés. L’éducation populaire, quelle que soit l’époque ou le lieu, a toujours consisté à s’éduquer en vue de s’émanciper. Plus concrètement, il s’agissait pour des groupes en situation d’oppression de développer une série de compétences et de codes qui allaient leur permettre d’avoir une prise, à la fois théorique et pratique, sur leur situation, de façon à pouvoir la transformer et vivre une vie digne.
Pour ce faire, il ne s’agissait pas d’engendrer une « simple » « prise de conscience » auprès des groupes concernés : elles et ils connaissaient très bien les dynamiques de pouvoir dans lesquelles elles et ils étaient prises. Il s’agissait plutôt de complémenter une vision du monde déjà existante avec une compréhension qui fasse d’elles et d’eux les acteurices de leur propre vie, de son changement, de sa libération de la situation d’oppression et donc d’une transformation sociétale.
Or le développement et la maitrise de ces nouveaux outils culturels ne pouvaient pas faire l’économie de la lecture et de l’écriture : c’est par ces biais-là que, dans nos sociétés occidentales modernes, on a encore tendance à faire transiter l’information. C’est ainsi que, très vite, l’alphabétisation se lia profondément et durablement à l’éducation populaire.
J’avais alors en tête que l’écriture, en tant que capacité apprise parmi d’autres en éducation populaire, remplissait trois rôles distincts. J’aimais distinguer ces rôles, mais ils étaient, en réalité, fortement entremêlés et tout à fait complémentaires.
- D’un point de vue très pragmatique, la maitrise de l’écriture était liée à des enjeux d’autonomie dans la société. Il s’agissait, par exemple, de pouvoir signer des documents, transmettre des informations de base à l’administration publique, mais aussi prendre note d’informations importantes ou maitriser plus amplement la communication écrite pour accéder à certains postes de travail.
- L’écriture était aussi liée à des enjeux de légitimité culturelle. Pouvoir écrire, c’était maitriser une compétence qui permettait d’accéder et même de participer à la culture considérée alors comme légitime. Savoir écrire permettait de revendiquer une égalité culturelle malgré les fossés sociaux. Cela un impact direct sur l’estime de soi et, plus largement, la confiance en soi et la façon dont on se perçoit soi-même au sein de notre société.
- Ensuite, du point de vue de l’engagement politique, maitriser l’écriture c’était accéder au monde des livres, et donc devenir le vecteur d’idées, de réflexions, de points de vue critiques : l’écriture devenait la meilleure façon de porter les autres vers une émancipation intellectuelle qui, dans le meilleur des cas, conduirait à une conscientisation et à des initiatives politiques pour se libérer de sa condition sociale.
L’écriture, entendue au sens large, devenait ainsi l’une des conditions nécessaires de l’émancipation, entendue comme libération de la situation d’oppression et comme transformation sociopolitique.
Le désir d’écrire
C’est avec la conscience de ce lien entre écriture et éducation populaire que je suis arrivé à Nadaillat, en Auvergne, pour rencontrer les acteurices du réseau des Créfad. La semaine toute entière avait été dédiée à la question de l’accompagnement à l’écriture, et c’est là, perché dans les hauteurs sous un ciel implacable, que nous avons partagé nos réflexions, et surtout nos expériences… C’était pour moi une nouvelle occasion en tant que nouvelle recrue du secteur associatif, d’échanger avec des formateurices et animateurices et de découvrir la réalité de celles et ceux qui accompagnaient l’écriture et le processus de son apprentissage. Là, les profils qui constituaient les groupes avec lesquels ellesils travaillaient étaient très variés, de même que les méthodes et les nombreux outils qui étaient mobilisés. C’était pour moi un univers riche de pratiques.
Au fil des discussions, un élément a fini par attirer notre attention. Quelles que soient l’approche, la méthode ou les personnes avec lesquelles on travaillait, un point commun nous réunissait toustes : il s’agissait pour nous de faire preuve d’une attention toute particulière envers ce qu’on a d’abord nommé le désir d’écrire. Qu’est-ce que désignait le « désir d’écrire » ? Mettre des mots dessus n’était pas évident, mais on sentait toustes de quoi il en retournait : c’était une sorte de pulsion, une envie qui amenait les unes et les autres à s’emparer de l’écriture et à vouloir s’en emparer toujours plus.
Mais c’était un sentiment extrêmement fragile, un sentiment encore plus précaire que la confiance. Faire naitre le désir d’écrire n’était pas quelque chose qu’on pouvait décider de faire comme n’importe quelle autre. Son apparition était rare, et d’autant plus précieuse qu’elle pouvait disparaitre à tout moment. Il suffisait d’un rien pour la détruire et la faire fuir à tout jamais. L’activité apparemment banale de l’accompagnement à l’écriture m’a alors semblé être d’une difficulté sans nom. Elle supposait un soin particulièrement exigeant, une vigilance de tous les instants envers ce qui pouvait menacer le désir d’écrire. J’avais en même temps l’impression que cela nous concernait toustes : formateurices, animateurices, apprenantes et aussi tout le reste.
Je me suis alors demandé : pourquoi l’accompagnement à l’écriture est-il devenu en un coup une activité aussi délicate ? Qu’est-ce qui se cachait derrière le désir d’écrire qu’il fallait à tout prix protéger ?
Peut-être faut-il protéger le désir d’écrire comme on protège le désir d’apprendre : parce qu’il est un moteur qui permet à la personne qui découvre l’écriture d’avancer et, un jour peut-être, de finir par en maitriser tous les recoins. Je n’étais pas tout à fait convaincu par cette réponse que me soufflait mon intuition. Quelque chose manquait. Nous n’étions pas seulement là pour que d’autres puissent acquérir une compétence. Il y avait plus !
Les violences de la langue
Ce qu’on essayait tant bien que mal de protéger ce n’était pas l’acquisition d’une compétence, mais bien l’élan qui animait la personne en face de nous et, en définitive, la personne en face de nous elle-même. De quoi tentions-nous de la protéger ? Peut-être était-ce de nous-même, en tant que formateurices, et probablement qu’il y a là du vrai : on ne sait que trop la violence écrasante que peut constituer une relation entre « celleux qui savent » et « celleux qui ne savent pas ». Nous ne sommes pas là pour inculquer nos petits savoirs aux autres et encore moins pour les imposer. Mais si nous tenions autant au désir d’écrire, n’était-on pas aussi en train d’essayer de nous protéger nous-même de quelque chose d’autre ?
Décidément, la violence venait d’ailleurs. Et si elle était sous nos yeux depuis le départ ? Et si la violence venait de ce vers quoi, précisément, on accompagnait nos apprenantes ? Ce vers quoi nous les accompagnons, ce qu’il y avait sous nos yeux depuis le début, ce qu’on manipulait et qu’on apprenait à manipuler ensemble n’est autre que la langue.
La langue est le matériau même que l’on se met à travailler en écrivant, et que nous travaillons ensemble lors de l’accompagnement à l’écriture. C’est un matériau extrêmement pratique qui nous ouvre les portes de la communication, de la réflexion et de l’expression, mais il peut aussi véhiculer la violence des injonctions et des catégorisations : il peut exclure, contraindre et même blesser. J’avais l’impression que la langue, prise en soi, n’était ni bonne ni mauvaise, et que tout dépendait de qui s’en emparait, des raisons pour lesquelles on s’en emparait, et de son utilisation.
La langue était donc ce matériau incertain qui pouvait se faire le porteur des valeurs les plus néfastes, le véhicule des intentions et des systèmes de contrôle les plus oppressants : violence de la langue dans la bouche du professeur, violence de la langue dans la bouche des autorités, violence de la langue dans la bouche de la culture dominante, violence de la langue incompréhensible des administrations et ainsi de suite.
L’accompagnement à l’écriture se dotait alors d’une dimension tout à fait nouvelle. Lors de nos ateliers, on avait pu pressentir cette dimension au moment où on jouait avec les prépositions en multipliant les combinaisons : accompagner à l’écriture, accompagner vers l’écriture, accompagner dans l’écriture, accompagner avec l’écriture… La langue, en tant qu’elle est prise dans ces dynamiques de pouvoir, en tant qu’elle participe d’un système peuplé de rapports de force – qui n’est autre que notre société, avec sa structure, ses inégalités, ses hiérarchies – implique toujours un positionnement dans ces dynamiques et ces rapports. Ce vers quoi nous accompagnons – avec l’écriture – c’était, en réalité, une position dans la société. La question suivante s’est alors posée à moi : allions-nous accompagner vers une langue qui allait nous faire rentrer dans les cadres de la société et nous y adapter, ou alors allions-nous accompagner vers une langue qui nous permettrait d’y trouver notre place et de s’émanciper ?
Une langue qui libère
Le danger de perdre le désir d’écrire c’était aussi le danger de perdre la possibilité d’une place digne dans ce monde. Le danger, c’était de devenir soi-même l’hôte d’une langue non choisie et imposée : la langue dominante, la langue déjà-là, non questionnée, avec ses difficultés, son inaccessibilité et ses violences : une langue dont on est expropriées à peine l’a-t-on apprise.
Protéger le désir d’écrire c’était donc protéger les apprenantes de cette aliénation, c’était se protéger nous-mêmes de devenir les instigateurices de cette violence, c’était garder la possibilité ouverte d’une langue à soi qui nous libère, ensemble, et qui nous permette de choisir notre place indépendamment des valeurs et de la culture dominantes.
Mais comment faire pour manipuler et transmettre ce matériau fantastique qui pouvait, à tout moment, se révéler entre nos mains, porteur d’une violence insoupçonnée ?
Lors de notre séjour à Nadaillat, deux moments peu ordinaires m’ont donné la réponse : les ateliers de chant et de danse. Personne n’avait vraiment l’habitude de chanter ou de danser, excepté les animateurices. Entre le début et la fin de l’atelier, certaines avaient l’impression que quelque chose avait changé : on se sentait bien, pleines de vie et comme libérées de quelque chose. Si oser chanter et danser n’était pas évident, c’est parce que l’exploration à laquelle ces deux activités nous livraient nous sortait de nos habitudes, ces habitudes qui avaient fini par raidir et parfois figer nos corps et nos voix. Pendant de longues années, nos corps et nos voix suivaient un cours qui semblait naturel, mais qui avait en fait été modulé par tout ce qu’on avait traversé dans la société : la famille, l’école, le travail, les obligations, les adaptations… Comme la langue, ces deux matériaux participaient de ce vaste système structuré de rapports de forces et de dynamiques de pouvoir. Ce que faisaient le chant et la danse, c’était venir déranger les sédiments, remuer la fange, malaxer ces matériaux que sont le corps et la voix.
Là est aussi, je crois, le destin de l’écriture : malaxer la langue, ne pas la laisser se sédimenter, ne pas se laisser se sédimenter soi-même. Cela requiert, comme pour le chant et la danse, d’explorer sans cesse les possibilités de la langue et de ne pas l’accepter comme telle (on ne sait jamais vraiment ce qui nous tombe entre les mains). Demandons-nous, ensemble, ce qu’il en est de son vocabulaire, de sa tonalité, de son accessibilité, des catégories qu’elle forme et des exclusions qu’elle se rend capable de produire, de son appropriation et des réalités qu’elle permet de faire voir et sentir ; car, peut-être y a-t-il, dans l’accompagnement à l’écriture, les germes de cette langue à venir et à construire ensemble, toujours ensemble.